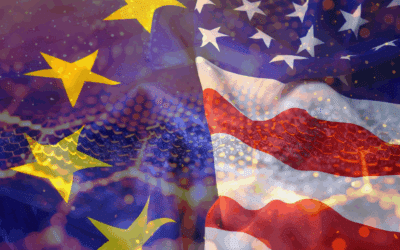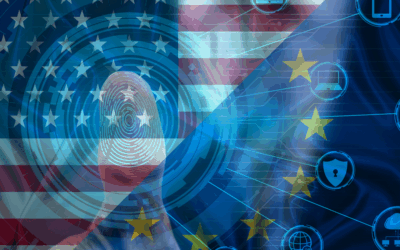Nous avons examiné les impacts sur la Législation Française de la Presse et de l’Audiovisuel du règlement européen sur la liberté des médias
Introduction
Le règlement Media Freedom Act vise à harmoniser les obligations du secteur de la presse et de l’audiovisuel au sein de l’Union européenne. Cependant, il a regroupé sous le même cadre législatif des secteurs qui, historiquement et juridiquement, fonctionnent sur des bases très différentes. En effet, la presse et l’audiovisuel répondent à des besoins et des régulations distinctes. D’ailleurs la législation française s’appuie sur deux textes de loi : celle de 1881 pour la presse et celle de 1986 pour l’audiovisuel. L’application d’un cadre unique néglige les différences fondamentales entre ces deux secteurs, rendant la mise en œuvre du règlement complexe et peu adaptée aux réalités de chaque secteur.
A) Base Juridique Différente : La presse est régie notamment par la loi de 1881 en France, qui garantit une grande liberté rédactionnelle et de publication. À l’inverse, l’audiovisuel est davantage encadré par des régulations liées à la diffusion, à la programmation et la gestion des chaînes comme stipulé dans la loi de 1986 en France.
B) Contraintes Techniques et Éditoriales : Les impératifs techniques et éditoriaux de la presse écrite ne sont pas les mêmes que ceux de l’audiovisuel
Affaiblissement de la Législation Française
La France se distingue par une législation très protectrice en matière de liberté de la presse, notamment cette loi de 1881. Le Media Freedom Act va affaiblir cette protection en imposant des régulations non adaptées :
Contradictions avec la Loi de 1881 :
La loi française de 1881 sur la liberté de la presse est particulièrement protectrice en matière de droits des journalistes, la sécurité des sources et surtout elle impose une responsabilité stricte aux éditeurs de presse à travers le mécanisme de responsabilité du directeur de la publication. Cette approche très singulière en Europe (la plupart des Etats membres n’ayant pas introduit cette protection) tout simplement parce que dans la majorité des Etats membres, le journaliste est responsable du contenu publié.
En outre, le droit français en matière de liberté de presse, n’impose aucune condition préalable à une publication d’un contenu. Le contrôle s’exerce par le juge à postériori.
Il y a dans le texte européen certaines mesures introduisant des dispositions limitant ces deux dispositions et cela pourrait introduire des ambiguïtés ou contradictions entre le cadre européen et le cadre national.
Par exemple, la loi française offre une protection robuste des sources des journalistes, essentielle pour garantir la sécurité et la confidentialité des informations sensibles. Le règlement impose des conditions permettant aux autorités de demander des précisions sur les sources, ce qui compromettrait cette protection.
Le Media Freedom Act introduit donc des mesures qui, bien qu’orientées vers une harmonisation européenne, viennent percuter de plein fouet les régulations nationales, notamment celles qui encadrent la lutte contre la désinformation. Cette situation s’explique par la grande hétérogénéité entre les Etats membres en matière de liberté éditoriale. Wen voulant harmoniser le droit européen, EMFA s’accommode mal des régimes juridiques les plus avancés comme c’est le cas en France.
A titre d’exemple : en ce qui concerne la liberté d’expression, bien que les deux textes visent à la protéger, leur approche diverge, créant des tensions sur la manière dont les informations peuvent être publiées ou régulées en créant un organe de contrôle compétent dans le domaine de la presse, c’est l’architecture de la loi de 1881 organisée autour du juge judiciaire qui est fragilisée
Incompatibilité avec la Loi de 1986 :
Elle encadre rigoureusement le secteur de l’audiovisuel en France, en imposant des quotas de diffusion, des règles de diversité et des obligations de production. Certaines dispositions du règlement peuvent conduire à une sur-régulation entravant la capacité à informer librement.
Il convient de rappeler que la directive SMA établit les principes fondamentaux pour les services de médias audiovisuels dans l’Union européenne, en garantissant la protection de la diversité culturelle et la liberté d’expression. Le règlement MFA, en introduisant des normes européennes uniformes, va entrer en conflit avec les directives SMA de plusieurs points :
A) Uniformisation des normes : La diversité culturelle est au cœur de la directive SMA, et permet à chaque État membre d’adapter les réglementations selon ses contextes culturels. Le MFA, en imposant des normes uniformes, risque de limiter cette adaptation, entraînant une perte de diversité dans les contenus médiatiques.
B) Contrôle et régulation : Les mécanismes de contrôle proposés par le MFA vont créer une forme de censure indirecte, en contradiction avec la liberté d’expression protégée par la directive SMA. L’imposition de normes européennes obligera les médias à modifier leurs contenus pour se conformer aux nouvelles directives, réduisant ainsi la liberté éditoriale
En France, ces sujets sont abordés avec soin afin de garantir un équilibre entre liberté d’expression et protection du public contre les contenus faux ou manipulés. Les lois existantes, telles que celles visant à contrer la diffusion de fausses informations en périodes électorales, pourraient être affaiblies par les dispositions du règlement européen, qui apparaît moins rigoureux sur ces aspects. Cela pourrait entraîner une fragilisation du cadre français, ouvrant la porte à des manipulations médiatiques et compromettant les efforts pour protéger le débat public contre les dérives de la désinformation
Un autre risque majeur identifié dans le Media Freedom Act, est relatif au contrôle de la concentration des médias. La loi de 1881 protège contre la monopolisation de la presse, en favorisant la diversité et la pluralité des voix. Le texte européen, en établissant des critères communs entre la presse et l’audiovisuel, pourrait paradoxalement faciliter le contrôle des médias de presse par de grands groupes internationaux issus d’autres secteurs, réduisant considérablement le pouvoir des autorités nationales dans ce domaine. La difficulté pour les petits médias indépendants de se conformer aux nouvelles normes pourrait les pousser à fusionner ou à disparaître. De ce point de vue le degré de contrôle de la concentration des médias dépendra de la rigueur de l’application du règlement et des dynamiques économiques du secteur. A noter que cette disposition est en contradiction avec la directive Cabsat2 qui protège contre la monopolisation.
L’incohérence de cette législation existe également avec le règlement DSA et elle est une vraie difficulté. Le DSA propose une approche spécifique pour la régulation des contenus en ligne, adaptée aux contextes culturels et juridiques de chaque État membre. Le MFA va donc créer des tensions juridiques et des imprécisions
Conclusion
Il faut être bien conscient que le texte européen présenté comme une avancée vers une harmonisation européenne du droit de la presse et de celui de l’audiovisuel, mais qu’il a été conçu pour imposer à certains Etats membres de revoir leurs lois nationales qui étaient jugées par les institutions européennes comme très restrictives en matière de liberté de la presse.
La difficulté pour d’autres pays européens dont la France, dans lesquels les législations étaient très protectrices pour ces deux secteurs, réside dans la mise en œuvre du règlement qui s’avère complexe, notamment en ce qui concerne l’adaptation des textes français existants aux nouvelles exigences légales européennes. Cette situation risque de créer un environnement juridique incertain ce qui va fragiliser encore la pérennité et la diversité de ces deux secteurs.
Il faut enfin savoir ; qu’un règlement européen, contrairement à une directive, ne peut pas être transposé, il est directement applicable dans tous les États membres. En France, cela complique considérablement sa mise en œuvre. Sans possibilité de modifier de manière significative le texte européen, elle va être contrainte de modifier certaines lois nationales pour se conformer au nouveau cadre législatif et les ajustements nécessaires au respect des nouvelles normes européennes vont réduire la protection et les spécificités des lois françaises, compromettant ainsi les standards qui avaient été établis pour garantir la liberté et la diversité des médias dans le pays.

Colette Bouckaert
Secrétaire générale iDFrights
Responsable des affaires publiques