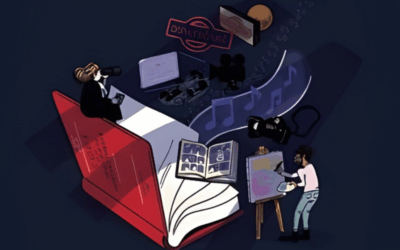Chercher à adapter les législations existantes, que ce soit la directive droit d’auteur/droit voisin, soit le règlement IA Act ou encore le RGPD, est dangereux et ne peut mener à aucune solution viable pour les secteurs de la Propriété Intellectuelle
I – L’intérêt légitime dans le RGPD
L’utilisation de « l’intérêt légitime » comme base juridique pour le traitement des données personnelles dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) suscite des préoccupations majeures, notamment en ce qui concerne le développement des modèles d’intelligence artificielle (IA). Bien que « l’intérêt légitime » puisse offrir une flexibilité appréciable pour les fournisseurs d’IA, son application dans le contexte de l’IA générative soulève des questions éthiques et juridiques.
Tout d’abord, l’un des principaux dangers réside dans le risque de contournement des protections offertes par le RGPD. Les fournisseurs de services d’IA pourraient être tentés d’interpréter l’intérêt légitime de manière extensive, permettant ainsi un traitement des données qui ne respecte pas les attentes raisonnables des personnes concernées. Par exemple, une entreprise pourrait justifier la collecte de données sensibles en arguant qu’elle agit dans son intérêt légitime, sans véritablement prendre en compte les droits des individus. Cela pourrait aboutir à des pratiques intrusives, où les données sont utilisées de manière disproportionnée ou sans consentement éclairé.
Ensuite, l’absence d’une définition claire de ce qui constitue un « intérêt légitime » peut créer un déséquilibre entre les intérêts des entreprises et les droits des individus. Les personnes dont les données sont traitées pourraient se sentir vulnérables et exploitées, car leurs droits à la vie privée, à la protection des données et celle des droits de propriété intellectuelle, pourraient être sacrifiés au profit d’objectifs commerciaux. De plus, la notion d’intérêt légitime implique une évaluation des impacts sur les droits et libertés des individus, mais cette évaluation peut être biaisée ou insuffisante, surtout si elle est réalisée par les mêmes entités qui bénéficient du traitement.
Par ailleurs, le développement de l’IA repose souvent sur l’analyse de grandes quantités de données, ce qui amplifie les risques associés à l’utilisation de l’intérêt légitime. Les algorithmes d’IA, entraînés sur des données collectées sans un consentement adéquat, peuvent reproduire des biais ou prendre des décisions discriminatoires. Ce phénomène de biais algorithmique soulève des questions éthiques sur la responsabilité des entreprises dans l’utilisation de données personnelles et l’impact sur les groupes marginalisés.
Enfin, le respect des droits des personnes doit être une priorité dans le cadre du développement des technologies, y compris l’IA. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les intérêts commerciaux et la protection des droits individuels. Les entreprises doivent non seulement respecter la lettre de la loi, mais également son esprit, en adoptant des pratiques transparentes et éthiques.
En résumé : bien que l’intérêt légitime puisse sembler une base juridique attrayante pour le traitement des données dans le contexte de l’IA, il comporte des risques significatifs qui peuvent nuire aux droits et aux intérêts des individus. Un encadrement rigoureux et une vigilance constante sont nécessaires pour garantir que les avancées technologiques ne se fasse pas au détriment des libertés fondamentales.
Dernière Minute : La Commission européenne a annoncé le 3 avril 2025 qu’elle prévoyait de présenter une proposition visant à réduire le règlement RGPD. Il est difficile à ce stade de savoir ce que la Commission entend simplifier. Cependant, c’est une des préconisations du rapport Draghi d’alléger cette législation pour permettre de rendre les entreprises européennes plus compétitives par rapport à leurs concurrentes aux Etats Unis. Il précisait notamment : « La position de l’UE en matière règlementaire vis-à-vis des entreprises de la Tech, entrave l’innovation. » Il faut bien reconnaître que pour les petites entreprises, l’application du RGPD était devenue un cauchemar tant du point de vue de la mise en conformité que du point de vue financier.
II – L’OPT IN : Passeport pour une utilisation éthique de l’IA
Les Limitations de l’Opt-out
Dans de nombreuses législations, l’Opt-out est souvent privilégié dans le cadre des procédures de protection des droits d’auteur et des droits voisins. Ce mécanisme permet à des utilisateurs de ne pas être soumis à des limitations de droits tant qu’ils n’ont pas exprimé leur opposition. En fait c’est OUI tant que l’on ne dit pas officiellement NON. Cependant, cette approche présente plusieurs faiblesses :
1. Complexité de la notification : Les utilisateurs peuvent ne pas être suffisamment informés des implications de leur consentement. Les termes et conditions sont souvent longs et complexes, rendant difficile la compréhension des droits qui leur sont accordés ou des utilisations qui peuvent être faites de leurs œuvres.
2. Incertitude juridique : Le cadre juridique actuel ne garantit pas toujours une protection adéquate des droits d’auteur face à l’utilisation croissante de l’IA générative. Par exemple, les algorithmes d’IA peuvent reproduire ou transformer des contenus protégés sans que les titulaires de droits aient été correctement informés ou aient consenti à cette utilisation.
3. Problèmes d’application : L’Opt-out peut entraîner des abus, où les droits des créateurs sont facilement contournés, car les utilisateurs ne prennent pas l’initiative de s’opposer à des pratiques de collecte et d’utilisation de données qui pourraient nuire à leurs intérêts.
Les Avantages de l’Opt-in
En revanche, un système d’Opt-in serait une approche plus robuste pour protéger les droits d’auteur et les droits voisins dans le cadre de l’IA générative :
1. Consentement éclairé : L’Opt-in exige que les utilisateurs donnent leur consentement explicite avant que leurs œuvres ne soient utilisées. Cela garantit que les créateurs d’œuvres ont une compréhension claire des utilisations potentielles de leurs créations et peuvent décider en toute connaissance de cause.
2. Protection renforcée des créateurs : En rendant le consentement obligatoire, l’Opt-in augmente la responsabilité des utilisateurs et des entreprises qui souhaitent exploiter des œuvres protégées. Les titulaires de droits peuvent ainsi mieux contrôler l’utilisation de leurs œuvres et éviter les exploitations non autorisées.
3. Renforcement de la confiance : Un cadre d’Opt-in peut favoriser une relation de confiance entre les créateurs et les utilisateurs. Les créateurs se sentiraient plus en sécurité dans la protection de leurs droits, ce qui pourrait encourager la création de nouvelles œuvres et l’innovation.
4. Adaptation à l’IA : Avec l’évolution rapide de la technologie et de l’IA, un système d’Opt-in peut être plus facilement convenir aux nouvelles réalités du marché. Il permettrait d’établir des normes claires sur l’utilisation des œuvres dans les systèmes d’IA, garantissant ainsi une protection adéquate des droits d’auteur.
5. Encouragement des pratiques éthiques : En intégrant l’Opt-in, les entreprises seraient incitées à adopter des pratiques éthiques en matière d’utilisation des données, ce qui pourrait contribuer à une meilleure réputation et à une fidélisation des utilisateurs.
En résumé: bien que l’Opt-out soit souvent utilisé dans le cadre des procédures de protection des droits d’auteur et des droits voisins, il présente des lacunes qui peuvent compromettre la protection des créateurs, notamment dans le contexte de l’IA. L’Opt-in, en revanche, offre une approche plus fiable et éthique, en garantissant que les droits des auteurs soient respectés et que les utilisateurs donnent leur consentement éclairé avant l’utilisation de leurs œuvres. En promouvant un cadre juridique basé sur l’Opt-in, il est possible de renforcer la confiance, de protéger les droits d’auteur et de favoriser un environnement d’innovation respectueux des créateurs.
III – Le Test en trois étapes qui a été établi par le droit international dans le cadre de la Convention de Berne.
Le texte vise à limiter les exceptions et les limitations au droit d’auteur pour qu’une exception soit valable, elle doit répondre aux trois critères suivants :
- Le but légitime: l’exception doit viser un but précis, tel que la citation, l’enseignement ou la critique
- La portée limitée: l’exception doit être limitée, ce qui veut dire qu’elle ne doit pas nuire à l’exploitation normale de l’œuvre, ou causer un préjudice injustifié au droit d’auteur
- La proportionnalité: l’utilisation doit être proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi.
L’IA générative, ne répond pas vraiment à ces critères lorsqu’elle génère du contenu original ou utilise des œuvres protégées :
- Le but spécifique: Les usages de l’IA sont variés et ne répondent pas à un but éducatif ou critique.
- La portée limitée: L’utilisation de l’IA pour reproduire ou transformer des œuvres peut dépasser les limites raisonnables, notamment lorsqu’elle entraîne une diffusion massive sans autorisation.
- La proportionnalité: l’Impact de l’IA sur le marché des œuvres protégées est difficile à évaluer
En résumé : l’IA ne remplit pas les conditions du test en trois étapes car ses usages sont trop larges et trop variés pour répondre aux critères stricts du test.
IV – Conclusion
En matière de protection de la propriété intellectuelle, il ne faut surtout pas essayer de triturer le droit d’auteur/droit voisin existant pour vouloir absolument y faire entrer l’IA générative. On aboutit toujours à des solutions incomplètes voire qui conduisent toujours à une insécurité juridique.
Il est urgent de se pencher sur la recherche d’une véritable base juridique qui puisse protéger les ayants droits de manière incontestable.
Les systèmes d’IA générative ont besoin de beaucoup de données pour s’entraîner, souvent collectées sur internet. Ils utilisent aussi des sources externes pour répondre aux questions.
Un enjeu important est de savoir comment les auteurs peuvent protéger leurs droits dans ce contexte, ce qui nécessite une bonne documentation sur les sources utilisées.
Le Professeur Sebastian Stober qui enseigne au Laboratoire de l’Intelligence artificielle Otto-von Guericke à l’Université de Magdeburg en Allemagne a peut-être un début de réponse.
Il considère qu’il est important de faire la différence entre les données utilisées pour l’entrainement du système et celles retenues lors de son utilisation. Les données d’entraînement influencent la qualité du modèle sur le long terme, tandis que les données d’entrée impactent directement le contenu généré. C’est extrêmement intéressant et l’Institut est d’avis qu’il faut non seulement suivre ses travaux, mais réfléchir à la façon de transposer juridiquement ce qu’il propose et qui pourrait être une vraie ouverture pour la protection des droits de la propriété intellectuelle.

Colette Bouckaert
Secrétaire Générale iDFright