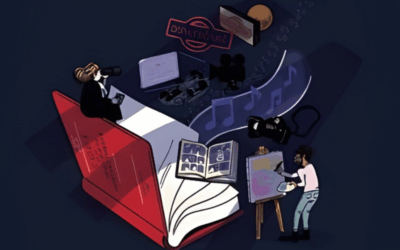L’intégration européenne fut dès ses débuts basée sur la démocratie et l’état de droit. Cette forte affirmation fut traduite dans la constitution des institutions. La Cour de Justice fut d’emblée l’une des quatre institutions des Communautés européennes.
Avec cette prémisse, le rôle de la Cour ne pouvait qu’être essentiel dans l’intégration qui était à suivre. Le rapprochement toujours plus étroit des peuples s’est donc fait de manière centrale aussi par la jurisprudence de la Cour.
La propriété intellectuelle au sens large, c’est-à-dire la propriété littéraire et artistique et les droits de propriété industrielle tels les brevets, les marques et les dessins et modèles pour citer les plus utilisés, ne rentrait pas dans le champ des compétences de la Communauté économique européenne. Elle était uniquement mentionnée comme une exception à la libre circulation des marchandises à l’article 36 CEE. Cette situation a complètement changé depuis. Les directives d’harmonisation des droits d’auteurs sont nombreuses ainsi que celles qui rapprochent les droits des marques, dessins et modèles ou les brevets. Plus encore, le niveau considérable de l’intégration économique atteint a amené les institutions à mettre en place des droits unitaires (marque UE, dessins et modèles enregistrés et non enregistré de l’UE, brevets à effet unitaire, indications géographiques protégées, variétés végétales).
Ces titres de propriété intellectuelle (à l’exception des indications géographiques protégées qui sont essentiellement protégées au niveau de l’UE) existent en pleine cohabitation avec les titres nationaux.
Les droits de propriété intellectuelle (ci-après DPI) de et dans l’UE sont donc essentiels mais aussi complexes et touffus. Ces différents droits interagissent, peuvent se cumuler et être en contradiction. Ils se créent dans des espaces juridiques différents (national, régional -comme pour le Benelux- et de l’Union), ont des durées de protection variées et bien souvent des titulaires différents d’un Etat Membre à l’autre.
La complexité intrinsèque du droit en cette matière est d’autant plus grande que chacun des DPI a un objet spécifique différent et des mécanismes d’acquisitions ou de naissance particuliers (un droit d’auteur nait de la création et de la simple fixation sur un support d’une oeuvre sans autre exigence de formalité, en revanche, les droits de protection industrielle, à la notable exception du dessin ou modèle non enregistré, requièrent un dépôt auprès d’un institut de propriété industrielle).
Dans cet environnement juridique particulièrement complexe, la CJCE (de nos jours la CJUE – Cour de Justice de l’Union Européenne – qui comprend deux degrés de juridiction que sont la Cour elle-même et le Tribunal général) a d’abord dû mettre en place les éléments institutionnels puisque la CEE n’avait pas de compétence en matière de DPI. Ces législations peuvent par leur essence même être en contradiction avec les règles de libre circulation. En effet, les DPI sont en principe des droits exclusifs pour leur titulaire d’autoriser ou d’interdire la reproduction d’objets protégés, ou de vendre des biens produits avec l’utilisation de l’invention ou portant le signe distinctif protégé. Dans la mesure où les droits sont géographiquement limités au territoire pour lesquels ils ont été enregistrés ou pour l’Etat Membre dans lequel la protection est demandée, la libre circulation des marchandises en est forcément impactée.
Dès les années 1970, la CJUE a posé la différence entre l’existence et l’exercice des droits comme la règle de répartition des compétences en cette matière entre les Etats Membres et les Communautés. Les droits étant à l’époque purement nationaux, la Cour a estimé que leur existence relevait uniquement des Etats Membres. Cependant puisque ces droits peuvent mener à des entraves pour les quatre libertés, leurs utilisations peuvent être soumise au contrôle des institutions. Celles-ci sont donc en droit de vérifier si les titulaires de DPI ne bloquent pas indûment la libre circulation des biens et services ou mettent en cause la libre concurrence. Le deuxième problème était dans l’utilisation des droits. Le titulaire peut-il exercer son droit exclusif à de multiples reprises et de manière répétée sur le même objet (un titulaire de brevet peut-il interdire la vente de son produit fabriqué avec son procédé breveté, dans chaque Etat Membre même s’il a antérieurement consenti à celle-ci dans un autre Etat Membre ?) La Cour a clairement répondu que non. Une fois un produit mis sur le marché dans l’UE par le titulaire du DPI ou avec son consentement, tout acte de commercialisation ultérieur par des tiers est légal. C’est la règle de l’épuisement des DPI au sein de l’Union qui ne connait comme exception que les cas de réemballage des produits pharmaceutiques (c’est le cas des médicaments qui font l’objet d’importations parallèles et sont reconditionnés par les importateurs).
Ces principes ont été discutés par la doctrine mais ont été rapidement et totalement acceptés. L’autorité de la Cour sur ces points n’est pas en cause mais la jurisprudence de la Cour sur d’autres éléments du droit de la propriété intellectuelle est parfois fortement critiquée.
Il faut dire que les choses avaient plutôt mal commencé en matière de marques. Dans un arrêt de 1974 dit Hag I (affaire C-192/73), la Cour s’est, en effet et de l’avis général, fourvoyée. Elle avait estimé que le titulaire d’une marque ne pouvait pas s’opposer à la commercialisation par une personne de produits identiques couverts par la même marque dans un autre Etat Membre au motif que la titularité de cette marque était le résultat d’un transfert ultérieur à sa création.
Le droit des marques était remis en cause et la confiance des milieux spécialisés s’en est trouvée affectée. S’il est affirmé ici que la Cour s’est fourvoyée, c’est qu’elle a admis expressément son erreur dans un arrêt Hag II (affaire 10/89). Depuis la Cour et le Tribunal Général (TG) ont rendu des milliers de décisions en matière de marques. La plupart sont du Tribunal Général sur des recours contre des décisions de l’Office de l’Union Européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) quant aux enregistrements de marques de UE. Cette jurisprudence volumineuse et nombreuse est évidemment l’objet de critiques dans certains cas mais pour le moins l’autorité de la Cour n’est plus remise en cause. Cela est d’autant plus vrai que depuis le doublement des juges au Tribunal Général, bien des juges recrutés sont des spécialistes du droit des marques. De son côté la Cour elle-même a mis en place une jurisprudence claire et acceptée à l’occasion de nombreux renvois préjudiciels en interprétation sur demande des tribunaux nationaux (le renvoi préjudiciel en interprétation (RPI) est le mécanisme par lequel les juges nationaux – qui sont les juges de droit commun du droit de l’UE – demande à la CJUE de les éclairer en cas de doutes sur des questions de droit UE.
La jurisprudence de la Cour est considérée moins claire en matière de droit d’auteur et de brevets. Bien des critiques ont été émises à l’égard de l’interprétation du droit de communication au public, donc en droit de la propriété littéraire et artistique. Il faut dire que cette notion est particulièrement complexe. La consultation, la transmission ou le simple accès à des œuvres en ligne, obligent à mettre en place des raisonnements juridiques particuliers. Il est difficile de trouver des interprétations qui ne soient pas vues comme une accumulation de cas particuliers sans ligne forte et constante. Il faut en tout cas saluer la volonté de la Cour de vouloir protéger aussi efficacement que possible le droit des titulaires, tout en mettant en place une protection permettant l’accès aussi large que possible par les usagers. Réconcilier ces deux priorités et forcément difficile, comme le prouvent les négociations ardues lors de la mise en place de la Directive sur le droit d’auteur dans le marché numérique (DSM).
De plus, la Cour, qui était si prudente en matière de droit d’auteur jusque dans les années 2000, s’est montrée beaucoup plus audacieuse depuis. Le grand nombre de directives d’harmonisation du droit d’auteur et l’utilisation de l’interprétation téléologique (méthode d’interprétation du droit que la CJUE) depuis le début des Communautés européennes, a permis d’interpréter le droit de l’UE par rapport à ses objectifs plutôt que de le faire de façon strictement textuelle).
La Cour a donné ainsi à toutes les notions mentionnées dans les directives, une portée autonome du droit de l’Union Européenne. Il en est résulté notamment que la notion d’originalité qui est au cœur même du droit d’auteur s’est vu donner, à la lumière de ces directives et du droit international en la matière, une portée générale pour toutes les œuvres, alors que le législateur ne l’avait mise en place que dans des cas précis.
Le raisonnement de la Cour est solide et logique. Il était aussi prévisible au regard du droit de l’UE tel qu’il est interprété et appliqué depuis maintenant plus de 50 ans. A noter que cette extension de la notion d’originalité a été mal reçue notamment dans les pays anglo-saxons. Il est reproché à la Cour de faire de l’harmonisation judiciaire.
Mais c’est en matière de brevets, que la tension à l’égard de la jurisprudence et du rôle de la Cour en général a été la plus forte. Il en est résulté que lors de la création de la Juridiction unifiée des brevets (JUB), mise en place dans le cadre de l’adoption du brevet à effet unitaire, pour aligner les jurisprudences des tribunaux nationaux en matière de brevets en général, des voix se sont élevées pour limiter autant que possible le rôle de la CJUE. On aurait pourtant pu s’attendre à ce que la Cour joue un rôle clé dans ce développement. Tel n’a pas été le cas. Certains Etats Membres, certains juges spécialisés en matière de brevets et les milieux intéressés ont fortement poussé pour qu’une juridiction spécialisée se mette en place. Ceci se comprend aisément vu la particulière technicité du droit des brevets. Cela étant, cette juridiction devant statuer sur un droit aussi important quant au principe des quatre libertés et de la libre concurrence dans l’UE, il fallait par ailleurs respecter la compétence de la Cour au regard des traités. Le brevet à effet unitaire dans l’Union européenne ayant été créé par un règlement de l’UE, la compétence de la cour en matière de renvoi préjudiciel en interprétation était incontournable. Afin de pouvoir obtenir un accord sur la création de la JUB (Juridiction unifiée des brevets), certains Etats Membres (qui ne voulaient en aucun cas que la CJUE exerce une quelconque influence sur le développement du droit des brevets en tant que tel) ont tout simplement insisté pour que ce renvoi préjudiciel en interprétation soit retiré du règlement créant le brevet unitaire. Il en résulte un brevet unitaire dont le droit exclusif reste défini par le droit national. Cette solution a été fortement critiquée, notamment par la Commission, comme constituant un compromis remettant en cause le droit de l’UE, mais elle est en vigueur dans le droit actuel.
L’histoire de la CJUE et la propriété intellectuelle est celle de l’importance d’une branche du droit qui représente des intérêts économiques considérables. Elle relève des droits fondamentaux et notamment du droit de propriété (l’article 17(2), de la Charte des droits fondamentaux de l’UE qui prévoit expressément que les DPI sont protégés, mais aussi d’une spécificité (ou faudrait-il même dire de plusieurs spécificités) d’une rare complexité. Elle pose la question de la nécessité de mettre en place des juridictions spécialisées ou du moins de juridictions comprenant des juges qui eux sont pleinement au clair des technicités de ce droit. Ce sujet n’est pas qu’européen.
Aux Etats Unis notamment, la question a été posée et les dissensions entre la branche spécialisée du « Federal Circuit » (tribunal US spécialisé en matière de brevets mis en place en 1982) et la Cour Suprême (SCOTUS) sont légion. D’anciens juges du circuit fédéral allant jusqu’à affirmer que SCOTUS est parfaitement incompétente (sur le plan professionnel) en matière de brevets et que sa jurisprudence remet en cause l’innovation et le leadership US en matière de technologie.
La situation actuelle du droit de la propriété intellectuelle au sens large est complexe dans l’UE. Les juges nationaux qui sont les juges de droit commun sont compétents pour l’application du droit harmonisé. Dans certains cas, les Etats Membres ont limité le nombre des tribunaux afin de permettre une certaine spécialisation des juges et d’éviter que la jurisprudence soit trop peu homogène pour les marques et dessins et modèles dans UE.
Malheureusement, les règles de compétence nationale renvoient parfois à un grand nombre de tribunaux, comme c’est le cas pour le droit d’auteur et tous ces tribunaux peuvent à leur tour renvoyer des questions préjudicielles à la CJUE. C’est la raison pour laquelle dans l’accord lors de la création de la Juridiction Unifiée des Brevets, les tribunaux compétents en la matière ont été limités. Le droit des brevets n’étant pas inclus dans le règlement UE sur le brevet à effet unitaire, ces questions ne remonteront donc pas à la CJUE. Cela veut-il dire que celle-ci ne sera pas saisie de renvois préjudiciels d’interprétation du tout ? Il faut en douter, car le brevet est un instrument juridique qui a de fortes conséquences sur les marchés et notamment les questions liées aux brevets essentiels en matière de normes (Standard essential patents). La Commission a d’ailleurs proposé un règlement en cette matière. La Cour sera donc amenée à se prononcer. Par ailleurs, la Directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle a également des incidences sur le droit matériel de la PI. Les directives sur le commerce électronique ou les règlements sur le marché numérique (DSA, DMA) sont également essentiels et feront l’objet de biens des questions des juges nationaux à la Cour qui ne manqueront pas d’influer également sur les DPI.
Ainsi la question est posée : faut-il créer encore plus de tribunaux et cours spécialisés en propriété intellectuelles dans l’UE ? Avant de répondre à cette question, il faut se demander s’il est légitime de donner un statut dérogatoire à une branche entière du droit aussi importante et technique soit-elle. La création de tribunaux spécialisés est-elle la seule réponse à l’exigence de professionnalisme dans la décision judiciaire ou existe-t-il d’autres moyens pour arriver à une solution raisonnable ? Le recrutement de juges spécialisés à la CJUE et notamment au Tribunal Général est une première réponse. La formation des juges et les échanges entre eux en est une autre. Depuis plus de 15 ans l’EUIPO invitent les juges nationaux (pas seulement des juges spécialisés mais également ceux qui sont amenés à rendre des décisions de temps à autre en ces matières) à se rencontrer et à discuter de questions liées aux DPI.
L’Office européen des brevets fait de même en matière de brevets. Ces efforts doivent continuer et se renforcer.
L’intégration européenne est un acquis remarquable. Malgré des différences de traditions et de cultures juridiques importantes entre États Membres, tant sur le droit procédural que matériel, le rapprochement entre les droits nationaux est une réussite de tout premier ordre. C’est essentiellement à la CJUE et à sa position centrale dans nos institutions de l’UE que nous devons ces avancées. Il ne faut pas remettre en cause son rôle. Si des décisions malheureuses ont pu être prises, la Cour elle-même pourra les corriger. Par ailleurs l’activité législative considérable à laquelle nous assistons sur les différents aspects du marché numérique change notre droit en permanence et seule une CJUE centrale pourra nous permettre d’aller de l’avant de manière cohérente.

Paul Maier
Ancien Président des Chambres de recours de l’EUIPO et ancien Directeur de l’Observatoire européen des atteintes aux DPI
Membre du Conseil d’orientation Stratégique d’iDFrights