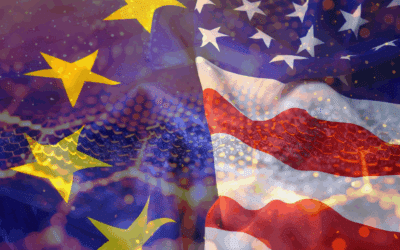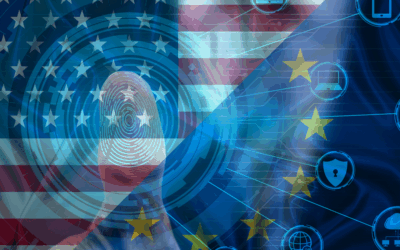À l’heure où la transformation numérique bouleverse les fondements de notre économie et expose nos infrastructures critiques mais aussi nos démocraties à des risques inédits, la souveraineté numérique s’impose comme un enjeu stratégique majeur. Face à la montée des puissances technologiques étrangères et à la circulation massive des données, la capacité d’un État à maîtriser ses propres outils numériques et à préserver la confidentialité de ses informations devient un impératif national. C’est dans ce contexte que l’initiative du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique mérite une analyse approfondie, tant les attentes sont élevées en matière d’indépendance technologique et de sécurité des données.
Tout d’abord, il convient de rappeler que la souveraineté numérique ne doit pas se résumer à un simple mot d’ordre ou à une posture politique : elle exige une compréhension fine de l’ensemble des enjeux économiques, industriels et géopolitiques liés à la maîtrise des technologies stratégiques. Les prises de position actuelles du Ministère restent générales et manquent de mesures précises adaptées aux réalités de terrain. Des promesses vagues ne peuvent répondre à la complexité du sujet ou à l’urgence des défis nationaux et européens.
Les entreprises européennes sont en effet exposées à des risques tels que la dépendance technologique, la pression réglementaire extra-européenne et la vulnérabilité à la captation des données sensibles. La communication gouvernementale actuelle ne présente pas de solutions concrètes permettant de prévoir une résolution rapide de ces problèmes. Le tissu industriel français est intégré aux chaînes de valeur mondiales. Il est encore aujourd’hui presque impossible pour une grande entreprise française d’être totalement indépendante des acteurs américains ou chinois, que ce soit par association, partenariat technologique, dépendance commerciale ou soutien financier. Même nos fleurons nationaux, qu’il s’agisse de l’aéronautique, de la défense ou de l’énergie, sont contraints d’interagir avec des groupements internationaux pour accéder à certains marchés, à certaines technologies ou encore au marché des capitaux. Les grandes entreprises du CAC 40 ont presque toutes, à un niveau ou à un autre, des actionnaires institutionnels étrangers ou dépendent de fournisseurs et partenaires stratégiques extra-européens.
Existe-t-il des exceptions ? : À l’heure actuelle, aucune grande entreprise française d’envergure internationale n’est totalement indépendante de toute association, partenariat technologique ou flux financier des acteurs américains ou chinois. Quelques entreprises de taille intermédiaire peuvent revendiquer une autonomie plus marquée, mais dès qu’elles atteignent la taille critique des grands groupes, l’internationalisation rend toute indépendance illusoire.
L’exigence d’indépendance vis-à-vis des grandes puissances étrangères relève aujourd’hui davantage de l’exception que de la règle. Cette réalité souligne l’importance, pour la France et l’Europe, de renforcer leur souveraineté dans le domaine des technologies stratégiques, tout en poursuivant une politique pragmatique d’ouverture et de coopération internationale. Pour l’heure, aucune grande entreprise française n’échappe à cette logique d’interdépendance qui structure le capitalisme globalisé contemporain.
L’indépendance numérique passe par le développement de solutions souveraines, portées par des acteurs nationaux. Franchir cette étape décisive dans l’affirmation d’une volonté collective de maîtrise et de sécurité nécessitera une véritable prise de conscience.
Nous en sommes loin et à titre d’exemple, l’annonce de la création d’un observatoire de la souveraineté numérique, prévue pour le mois de juillet, s’apparente davantage à la mise en place d’une nouvelle instance administrative — un nouveau « comité théodule » — qu’à une réponse opérationnelle et concrète aux besoins des entreprises et des administrations. La multiplication de rapports et d’études ne saurait remplacer l’adoption de solutions efficaces, alors même que les puissances technologiques concurrentes déploient depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies, des moyens considérables pour consolider leur indépendance stratégique ou renforcer leur hégémonie en Europe.
Par ailleurs, l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle illustre la rapidité des mutations en cours. Il ne suffit plus de se borner à la réflexion ou à l’annonce de pistes de travail ; l’enjeu réside désormais dans la capacité à initier, à soutenir et à concrétiser des actions ambitieuses. La France ne peut plus prétendre prendre de l’avance sur les acteurs extra-européens. Il s’agit maintenant de combler le retard accumulé, ce qui requiert une mobilisation sans précédent et des actions fortes, tant sur le plan légal que financier.
En l’absence d’une stratégie claire, d’actions coordonnées et de résultats concrets, la communication du Ministère ne répondra pas aux attentes. Affirmer une volonté sans l’accompagner d’engagements importants affaiblit notre crédibilité dans le domaine de la souveraineté numérique.
Quant au label SecNumCloud, censé représenter la souveraineté et l’excellence en matière d’hébergement de données sensibles, il démontre toute l’ambiguïté des politiques actuelles. Ce label, destiné surtout aux entreprises françaises et européennes, se veut un gage de sécurité et de concurrence loyale sur le marché du cloud, mais repose sur des bases contestables. Et surtout il permet aux entreprises extra-européennes de contourner ces règles pour accéder à ce label via l’association avec des entités françaises.
La question cruciale demeure celle de la rigueur des critères d’attribution du label. Or, l’examen des bénéficiaires révèle que plusieurs entreprises labellisées continuent d’entretenir des relations financières, technologiques ou capitalistiques avec des acteurs extraterritoriaux, notamment américains ou asiatiques. Ces partenariats — qu’ils prennent la forme de joint-ventures, de licences technologiques, de recours à des services tiers ou d’actionnariats croisés — créent des failles dans la chaîne de confiance. Il devient alors illusoire de prétendre à une protection totale des données ou à une autonomie stratégique.
Dès lors, l’invocation d’une concurrence loyale relève davantage du discours d’affichage que d’une réalité tangible. Les entreprises françaises, et en particulier les PME qui doivent déployer des moyens considérables pour accéder à ce label SecNumCloud, ne sont jamais complètement à l’abri des obligations légales étrangères — telles que le CLOUD Act américain et surtout la loi FISA — qui peuvent s’imposer à leurs partenaires ou fournisseurs. Cette situation nourrit le paradoxe d’une souveraineté proclamée mais continuellement compromise par le jeu de l’interdépendance globale.
En définitive, la force du label se dilue dans les concessions faites à la réalité économique et technologique. Il est loin d’être une garantie absolue et devient alors un outil symbolique, qui ne suffit ni à assurer une réelle étanchéité des solutions françaises ni à prémunir les utilisateurs contre les risques de fuite ou de captation de leurs données stratégiques.
Tant que la politique d’attribution ne sera pas revue avec une exigence accrue, adaptée à la complexité des liens extraterritoriaux, il sera difficile de faire du SecNumCloud autre chose qu’un argument commercial, incapable de répondre pleinement aux enjeux de souveraineté numérique.
L’initiative franco-allemande annoncée pour la rentrée, visant à élaborer une stratégie industrielle et réglementaire commune dans le domaine du numérique, s’inscrit dans cette quête d’autonomie.
Toutefois, le contexte géopolitique tendu et les divergences persistantes entre États membres de l’Union européenne jettent une ombre sur la capacité réelle à susciter des engagements partagés. Il existe un risque évident que cette démarche, aussi louable soit-elle, se heurte aux intérêts nationaux et à une fragmentation réglementaire que les acteurs extra-européens exploitent avec habileté.
Pourtant, il ne fait aucun doute que la souveraineté numérique constitue un levier décisif pour asseoir la résilience de l’économie européenne et stimuler l’innovation. Les ambitions affichées ne pourront être atteintes qu’au prix d’un engagement collectif renforcé, d’une volonté politique sans équivoque et d’une accélération flagrante des actions concrètes, bien au-delà du rythme observé jusque-là en France. Il ne s’agit plus de proclamer, mais d’ancrer la souveraineté numérique dans des mesures robustes, coordonnées et pérennes, capables de poser les fondations d’une autonomie réelle face aux défis d’aujourd’hui comme de demain.
La réussite d’une telle dynamique suppose d’aborder la question avec lucidité et détermination, sans céder au confort des demi-mesures ou au piège des annonces symboliques. À l’échelle européenne, seule une dynamique collective, fondée sur la confiance, la solidarité et la mutualisation des ressources, permettra de franchir le cap de la dépendance structurelle et d’instaurer une véritable autonomie stratégique dans le numérique.

Bernard Benhamou
Secrétaire Général de l’Institut de la souveraineté Numérique (ISN)
Membre du Conseil stratégique iDFrights

Colette Bouckaert
Secrétaire générale – responsable des affaires publiques iDFrights