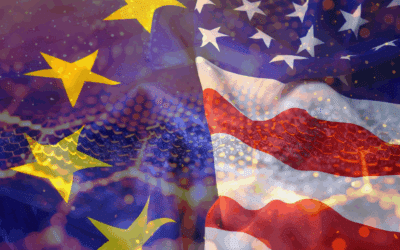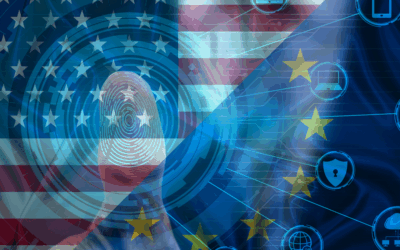Les droits fondamentaux dans le numérique, une évolution indispensable
La société numérique est en construction depuis un demi-siècle. Dès le début de cette construction, les plus avertis des développeurs et des juristes ont pointé du doigt les dérives possibles d’un système d’information et de communication planétaire qui serait construit sans prendre en compte les droits des individus. Le droit de la protection numérique des individus s’est construit au fur et à mesure que les menaces apparaissent.
Son fondement réside dans la protection de la vie privée, droit fondamental déjà existant avant l’apparition d’Internet. Mais cette approche trop restrictive n’est pas en mesure de répondre à tous les menaces observées et ressenties. Elle n’est pas en mesure non plus de faire face à l’impact historique que nos outils numériques ont sur les individus et l’organisation de nos sociétés.
Un demi-siècle plus tard, c’est toute une organisation économique et sociale, dont l’ampleur a été révélée par Edward Snowden, le « Capitalisme de Surveillance », une véritable économie de la surveillance décrite par Shoshana Zuboff, qui s’est mise en place de façon organique dans l’ensemble de nos sociétés avec la participation de nos États pourtant démocratiques. Cette économie se fonde sur la disponibilité des données personnelles considérées comme un objet dont on peut en faire le commerce. Face à ce développement, des lois de protections de données émergent, jusqu’à l’adoption du règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe qui constitue aujourd’hui le texte le plus agressif vis-à-vis des sociétés privées qui participent à cette économie de la surveillance. Si le RGPD épargne grandement les États eux-mêmes dans son champ d’application, il n’est en réalité qu’un outil de régulation du marché. Il ne remet pas question l’économie de la surveillance, il s’inscrit dans sa continuité en cherchant à en atténuer les effets.
Face à ce qu’on peut qualifier d’échec de l’approche de la protection des données, des voix se font entendre pour demander l’avènement d’un droit fondamental numérique. Le principe de l’autodétermination informationnelle fait son apparition dans la jurisprudence européenne. Les juges cherchent en effet à élargir la protection au-delà des atteintes à la vie privée. Mais coincés par la hiérarchie des normes, ils ne trouvent qu’un salut modeste auprès de l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui réaffirme le droit à la protection des données, consacre l’importance du consentement lors du traitement des données, mais encore une fois, ne remet pas en cause le modèle sous jacent.
En 2018, sur proposition de la CNIL, les autorités de protection des données personnelles francophones déclarent que « les données à caractère personnel sont des éléments constitutifs de la personne humaine, qui dispose, dès lors, de droits inaliénables sur celles-ci ». Cette affirmation est une attaque frontale à la notion de « données personnelle – objet ». On peut en déduire que les données personnelles sont alors assimilées à un élément de la personne au même titre que son corps. La proposition est fondamentale et pourtant passe inaperçue au point que la CNIL elle-même peine à pouvoir tirer les conséquences de sa proposition.
Depuis 2010, au sein de cercles de réflexion politique en Suisse sur le numérique, j’ai exploré l’extension concept d’intégrité de la personne à son existence numérique. Avec Grégoire Barbey, nous avons rédigé un essai « notre si précieuse intégrité numérique » sur la notion d’un droit à l’intégrité numérique. Dans cet essai, nous explorons également comment l’apparition d’un tel droit peut faire émerger une économie numérique bien différente de celle que nous connaissons et même d’une politique de sécurité revisitée pour protéger l’humain également dans sa sphère numérique.
Suite à cet ouvrage, ainsi qu’un colloque organisé par la Faculté de Droit de Neuchâtel, l’assemblée constituante valaisanne, en charge de la rédaction de la nouvelle Constitution du Canton du Valais, a décidé d’intégrer ce droit dans son projet. Après deux années de travail, la commission des droits fondamentaux de la Constituante valaisanne a posée les jalons d’un long travail juridique. Elle sort de l’approche classique de la protection des données qui cherche à éviter le « traitement abusif » des données en proposant une interdiction de principe au « traitement non-consenti » des données. Si ce principe apparaît dans le RGPD, il s’inscrit pour la première fois au niveau constitutionnel de façon explicite. Il s’agit d’un changement fondamental, car il transfère la charge de la preuve de celles et ceux qui font l’objet du traitement vers celles et ceux qui effectuent le traitement. Dans le même projet, le droit à l’intégrité numérique est accordé. Les constituants précisent cette notion notamment par la « capacité d’interagir librement par le biais de technologies numériques ». De même, un droit à un accès ouvert et sans discrimination au réseau internet est reconnu, comme celui de communiquer avec l’autorité sans être tenu d’utiliser exclusivement une technologie spécifique. Ce dernier droit a donné des idées aux juristes de la Chancellerie de l’État de Genève.
Un projet de loi constitutionnelle est déposé en 2021 au Grand Conseil genevois. Celui-ci propose l’introduction d’un article nouveau dans la Constitution reconnaissant le droit à la sauvegarde de l’intégrité numérique. La particularité de la proposition genevoise, qui sera présentée au peuple genevois lors de la votation du 18 juin 2023, est qu’elle inclut des droits connexes bien définis. Le texte présente une liste non-exhaustive. « L’intégrité numérique inclut notamment le droit d’être protégé contre le traitement abusif des données liées à sa vie numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique, le droit à une vie hors ligne ainsi que le droit à l’oubli. » Ce texte est riche en nouveautés. Le concept de « vie numérique » prend forme, le ton est donné. De la protection des données ont doit maintenant parler de protection des individus et de leur vie numérique. Le droit à l’oubli trouve enfin sa place dans la hiérarchie des normes, le droit à la vie hors ligne propose une abstraction de la proposition valaisanne qui reste très technique. Enfin le droit à la sécurité dans l’espace numérique permet un changement de paradigme profond de l’approche sécuritaire : le numérique ne peut pas simplement être vu par les autorités liées à la sécurité comme un outil qu’elles peuvent détruire au nom de luttes particulières, mais un espace qu’elles doivent sécuriser pour permettre aux citoyens d’y mener leur vie numérique en toute sérénité.
Depuis le Canton du Jura et de Neuchâtel ont également engagé les débats sur le droit à l’intégrité numérique. La question est posée au Parlement fédéral. À Neuchâtel, un autre droit est proposé. Le droit à ne pas être surveillé, analysé et mesuré. Ce droit avait été discuté par la commission des droits fondamentaux du Valais avant d’être écarté pour 6 voix contre 5. Ce droit nécessitera à lui-même des longs travaux d’études juridiques, car il donne une vision très claire sur le type de société que veulent les constituants. Une société qui respecte l’intégrité numérique et donc l’autonomie et la dignité des individus, qui reconnaît le droit à leur vie numérique est une société où le principe de surveillance est renversé. Une société démocratique numérique ne surveille pas.
Si l’on regarde qui sont les élus et les élues qui ont poussé ce débat, ce qui saute aux yeux est qu’ils sont issus de tous les partis. Lors des débats au Grand Conseil genevois, le consensus sur l’adoption du droit à l’intégrité numérique est extrêmement large. Dans la presse helvétique, on peut entendre quelques critiques, mais celles-ci émanent que de spécialistes de la protection des données. Peut-être ne sont ils pas préparés au changement qui les attends ?
Alexis Roussel, co-auteur de « Notre si précieuse intégrité numérique »
(éditions Slatkine)

Alexis Roussel
Co-auteur avec Grégoire Barbey de « Notre si précieuse intégrité numérique »
(Éditions Slatkine)