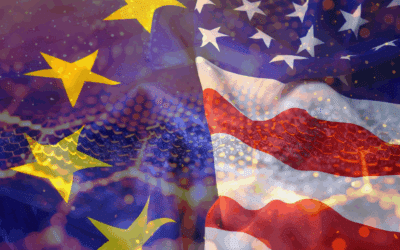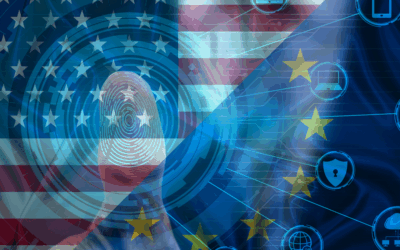LA BLOCKCHAIN : COMME ELEMENT DE PREUVE D’ANTERIORITE AFFAIRE AZ FACTORY / ELBAZ
Tribunal judiciaire de Marseille
Date du Jugement : 20 mars 2025 – numéro de rôle : RG n° 23/00046
Objet : Contrefaçon de vêtements protégés par le droit d’auteur
- Faits et procédure
La société « AZ Factory » fondée par le créateur Alber Elbaz et intégrée au groupe Richemont, a assigné la société chinoise « Valeria-moda » pour contrefaçon de modèles de pyjamas. Les croquis originaux avaient été horodatés via la solution BlockchainyourIP sur la blockchain publique Bitcoin en mai et septembre 2021.
Le litige portait sur la titularité des droits d’auteur et l’antériorité des créations, en l’absence de dépôt auprès d’un organisme officiel.
2. Problème juridique
La question centrale était de savoir si une preuve d’horodatage sur blockchain publique pouvait être juridiquement reconnue comme élément probant suffisant pour établir :
• L’antériorité des créations.
• La titularité des droits patrimoniaux d’auteur.
• L’originalité des œuvres.
3. Solution retenue par le tribunal
Le Tribunal judiciaire de Marseille, dans son jugement du 20 mars 2025, a reconnu que :
• L’horodatage sur blockchain publique constitue une preuve recevable au sens de l’article 1358 du Code civil (liberté de la preuve).
• La blockchain permet une certification d’antériorité fiable, grâce à son caractère décentralisé, infalsifiable et horodaté.
• La preuve blockchain est dans ce jugement combinée à d’autres éléments (marques déposées, communication, réseaux sociaux). Le tribunal a donc fondé sa décision sur un faisceau d’indices, ce qui signifie que l’inscription dans la blockchain ne suffit pas encore à elle seule à établir la titularité des droits.
Mais c’est la première fois qu’un tribunal européen reconnaît une preuve blockchain publique comme juridiquement valable dans un litige de contrefaçon. Le tribunal a accepté une preuve purement numérique, sans dépôt officiel ni intervention d’un organisme de propriété intellectuelle.
Cette reconnaissance de la preuve par blockchain par le tribunal de Marseille ouvre la voie à l’usage de la blockchain comme outil probatoire et constitue une avancée notable. Il serait sans doute intéressant de se pencher sur une approche plus précise et harmonisée pour envisager son application à l’échelle européenne, voire internationale.
Une harmonisation de ce type peut être réalisée, notamment par le biais d’initiatives telles que le règlement eIDAS 2 (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) entré en vigueur le 20 mai 2024 qui est une mise à jour du règlement n°910/2014 et vise à réguler les services de confiance numériques au sein de l’Union européenne, ou par l’adoption de normes internationales portant sur l’intégrité et la fiabilité des technologies de registres distribués. L’élaboration de lignes directrices communes ainsi que la coopération inter-juridictionnelle sont susceptibles de faciliter la reconnaissance transfrontalière de la preuve blockchain, renforçant ainsi la sécurité juridique des créateurs et des acteurs économiques dans un environnement mondialisé.

Colette Bouckaert
Secrétaire générale iDFrights
Consultante affaires publiques