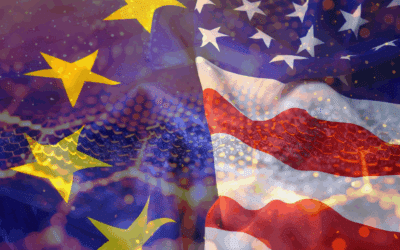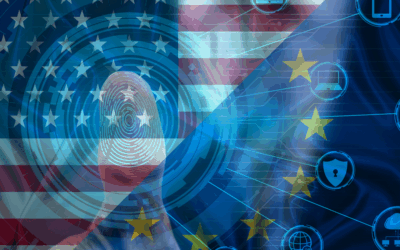La révision du RGPD, dans le cadre du paquet « Digital Omnibus », suscite de nombreuses réactions de la part des professionnels du numérique, de la filière culturelle et du secteur de la presse. Cette synthèse met en lumière les principaux enjeux juridiques et pédagogiques.
La Commission européenne souhaite simplifier la réglementation, notamment en réduisant la charge administrative de 25 à 35 %. Des mesures telles que le « Stop-the-clock » et l’allègement des obligations de conformité pour les PME et « mid-caps » sont présentées comme des leviers pour renforcer la compétitivité européenne face aux États-Unis et à la Chine.
- Simplification du RGPD : entre compétitivité et protection des libertés
Si la volonté de modernisation et de compétitivité est manifeste, les réformes envisagées soulèvent de vraies questions quant à la préservation des droits fondamentaux et à la sécurité juridique. La suppression du fondement « intérêt légitime » pourrait rendre le consentement obligatoire pour chaque traitement de données, impactant la publicité ciblée, la monétisation des contenus et l’analyse de marché. Cela risquerait de complexifier la gestion des œuvres et contenus protégés, au détriment des créateurs, éditeurs et agences de presse qui ont besoin de mécanismes fiables pour protéger leurs droits. L’affaiblissement du principe de proportionnalité et de la pseudonymisation inquiète ONG et juristes, qui redoutent un recul de la protection des données. La procédure transfrontalière, déjà complexe, pourrait perdre en efficacité, exposant davantage les citoyens à des risques liés à leur vie privée.
Données sensibles
L’article 9 du document de travail, portant sur les données sensibles, suscite de profondes préoccupations quant à ses effets potentiels. En l’absence de garanties suffisantes, il ouvrirait la voie à une utilisation abusive des données à caractère personnel, favorisant le profilage non autorisé et exposant les individus à des risques de discrimination.
Pour les ayants droit, éditeurs et agences de presse, ce relâchement du cadre juridique compromettrait la protection de leurs contenus et de leurs intérêts, en facilitant l’accès et le traitement non encadré des œuvres
Intérêt légitime :
Ce fondement juridique, prévu par le RGPD, permet à une organisation de traiter des données personnelles sans consentement préalable, si cela est nécessaire à la poursuite d’un objectif légitime, à condition que les droits des personnes soient respectés. Supprimer ce mécanisme risquerait d’entraver la prévention de la fraude, l’amélioration des services ou le marketing, et de compliquer la valorisation légale des œuvres et contenus, affectant la rémunération et le contrôle des ayants droit. Il est donc crucial que toute réforme conserve des outils juridiques solides garantissant sécurité, transparence et juste rémunération, tout en soutenant l’innovation et le respect des droits fondamentaux.
Publicité ciblée et monétisation des contenus :
La publicité ciblée, reposant sur la collecte et l’analyse des données, est essentielle au modèle économique notamment des éditeurs de contenus en ligne.Rendre le consentement systématique obligatoire pour chaque traitement risque de réduire les taux d’acceptation, limitant ainsi la rentabilité et la capacité des éditeurs à financer la création et la diffusion de contenus de qualité. Sans la possibilité de collecter et d’analyser les données, leur indépendance éditoriale et leur investissement dans des contenus originaux seraient menacés.
Pseudonymisation :
Cette technique dissocie les données personnelles de l’identité réelle, réduisant le risque de réidentification et d’usage abusif. Un affaiblissement de la pseudonymisation exposerait à des risques accrus de profilage, d’usurpation d’identité ou d’accès non autorisé aux données sensibles. Cela remettrait en cause l’équilibre entre innovation numérique et respect de la vie privée.
2 – Modification du règlement IA ACT
Le futur Digital Omnibus introduit également une tendance à la dérégulation de la législation, notamment du règlement IA ACT. Cette simplification, présentée comme un levier pour l’innovation, comporte en réalité des risques majeurs pour les ayants droit, éditeurs et agences de presse : elle pourrait affaiblir les protections existantes et faciliter l’exploitation non autorisée des œuvres, réduisant la capacité des ayants droit à contrôler l’utilisation de leurs contenus et à obtenir une rémunération équitable. Concernant l’article 6 relatif à l’enregistrement des systèmes d’IA dans une base de données publique, cette disposition doit être considérée comme un progrès en matière de transparence. Elle offrirait aux ayants droit, éditeurs et agences de presse la possibilité d’identifier plus facilement les systèmes exploitant leurs œuvres, de suivre l’utilisation de leurs contenus et de faire valoir leurs droits si nécessaire.
Toutefois, il est essentiel que cette transparence ne soit pas un substitut à des garanties juridiques solides : une simple inscription dans une base de données ne saurait suffire à protéger les intérêts des créateurs si la régulation sur l’utilisation des œuvres reste insuffisante. Il est donc impératif de maintenir une régulation forte et adaptée, garantissant à la fois l’innovation et la protection effective des droits des ayants droit et des éditeurs.
- Révision de la directive droit d’auteur et droit voisin : enjeux pour les ayants droit et éditeurs
L’annonce d’une révision de la directive 2019/790 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, dans le cadre du Bouclier démocratique puis du Digital Omnibus, suscite inquiétudes et incertitudes. Les ayants droit et éditeurs, après de longues négociations pour l’adoption de cette directive, craignent un affaiblissement de leurs garanties, notamment face à l’essor de l’intelligence artificielle et à l’exploitation massive des œuvres sans autorisation. La Commission européenne reconnaît que le piratage et l’utilisation non autorisée de contenus protégés pour l’entraînement des IA menacent la diversité et la qualité des médias, en réduisant les revenus des créateurs et éditeurs.
Toute révision doit préserver la capacité des créateurs à contrôler l’usage de leurs œuvres, garantir une rémunération équitable et assurer la diversité de l’information. Les éditeurs demandent le maintien de l’obligation de consentement pour l’exploitation des œuvres, la transparence sur l’utilisation dans les modèles d’IA, et le respect du droit voisin.
- Concilier innovation et protection des droits
La réforme doit trouver un équilibre : simplifier la réglementation sans sacrifier la protection des libertés, des droits d’auteur et des droits voisins. La compétitivité ne doit pas l’emporter sur la sécurité juridique, la confiance des citoyens et la pérennité des secteurs culturels et de la
presse. La modernisation doit viser clarté, cohérence et respect des principes éthiques européens. L’évolution du cadre réglementaire européen doit s’inscrire dans une démarche équilibrée, conciliant innovation, respect des droits fondamentaux et pérennité des modèles économiques des médias, de la presse et de la culture. Il s’agit de garantir à la fois la protection des données personnelles, la juste rémunération des créateurs et la diversité de l’offre éditoriale Seul un dialogue constructif entre l’ensemble des parties prenantes permettra de bâtir un environnement numérique à la fois dynamique, éthique et durable.

Jean-Marie Cavada
Président iDFRights

Colette Bouckaert
Consultante affaires publiques
Secrétaire générale iDFRights