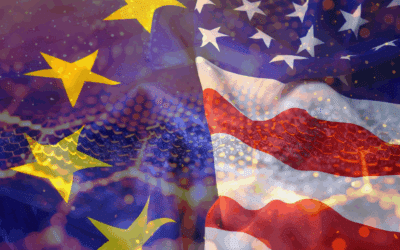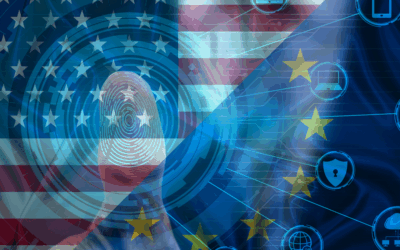Le Média Freedom Act (MFA) promulgué au niveau européen vise à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias au sein de l’Union européenne. Pour les éditeurs, agences de presse et le secteur de l’audiovisuel français, le règlement apporte plusieurs innovations mais certaines vont se heurter aux législations françaises en vigueur.
Des interrogations majeures pour l’avenir des secteurs concernés
Contrairement à la législation française, où la loi de 1881 sur la presse et celle de 1986 sur l’audiovisuel posent des cadres stricts pour garantir l’indépendance et la responsabilité des médias, le texte européen se distingue par une souplesse accrue. Il en résulte un grand nombre d’incompatibilités qui suscitent des inquiétudes parmi les professionnels des secteurs concernés, qui craignent que l’absence de règles précises ne compromette la protection des sources, la liberté éditoriale ou le pluralisme. Beaucoup s’interrogent sur l’impact réel de cette harmonisation européenne, face à des enjeux spécifiques à la scène médiatique hexagonale.
Entré en vigueur le 7 mai 2025, le Media Freedom Act s’applique pleinement depuis le 8 août 2025, marquant une nouvelle étape dans le paysage réglementaire européen.
I – DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES EDITEURS ET AGENCES DE PRESSE.
1) Le MFA prévoit que toute tentative d’intervention politique dans la ligne éditoriale ou dans la gouvernance des médias doit être proscrite dans un objectif de protection contre les ingérences étatiques et économiques et cultuelles.
Point de tension avec la loi de 1881
- L’introduction de mécanismes de régulation européens pouvant intervenir en cas de conflit ou de faille dans la protection des libertés pourrait être perçue comme une remise en cause de la souveraineté juridique nationale.
2) Selon le MFA, la responsabilité éditoriale peut être transférée ou étendue aux journalistes eux-mêmes. Cette possibilité découle de la flexibilité introduite par le règlement européen, qui n’impose pas systématiquement un responsable unique mais autorise, dans certains contextes, que la responsabilité d’un contenu soit directement portée par la ou les personnes ayant participé à sa rédaction, à sa validation ou à sa diffusion. Le transfert ou l’extension de cette responsabilité dépend alors des modalités d’organisation interne de chaque média et des procédures de gouvernance mises en place pour encadrer le processus éditorial, telles que prévues ou tolérées par le MFA.
Point de tension avec la loi de 1991
- La législation française attribue traditionnellement la responsabilité principale au directeur de publication. Le cadre européen qui permet ainsi d’adapter la répartition des responsabilités en fonction des pratiques nationales ou sectorielles rend complexe la détermination de la personne tenue pour responsable au sein d’une rédaction et introduit une incertitude sur la désignation du responsable final en cas de contentieux notamment lorsqu’une pluralité d’acteurs interviennent dans la chaîne de publication d’un contenu.
3) l’introduction de mécanismes de régulation dans le règlement permet d’intervenir en amont de la publication, sous couvert de surveillance ou d’exceptions pour motifs de sécurité nationale. Bien que la surveillance directe soit interdite par le texte, ces exceptions ouvrent la voie à des formes de contrôle sur la liberté de publier.
Point de tension avec la loi de 1881
- La loi française garantit la liberté de publier sans autorisation préalable. En clair, la possibilité pour les instances européennes d’intervenir et de contrôler (même de manière indirecte ou exceptionnelle) les publications médiatiques est perçue comme un contrôle préventif, contraire au principe de la liberté absolue de la presse tel que prévu dans la loi de 1881
4) L’introduction de procédures uniformisées pour le contrôle judiciaire dans le cadre du MFA (Media Freedom Act) s’inscrit dans la volonté européenne d’harmoniser les mécanismes de régulation applicables aux médias à travers l’Union. Cette uniformisation vise à garantir un traitement égal des situations litigieuses et à encadrer la gouvernance médiatique, en particulier lorsque plusieurs États membres sont concernés ou lorsque l’impact d’un contenu médiatique dépasse le seul cadre national.
Point de tension avec la loi de 1881.
- Ce choix d’uniformisation comporte un risque majeur : il pourrait limiter la capacité des juges nationaux à intervenir de façon autonome et selon les spécificités du droit local, notamment dans les cas où la législation nationale prévoit des garanties particulières en matière de liberté de la presse ou de protection des sources.
A souligner que notamment :
- Les juges nationaux pourraient se voir contraints d’appliquer des procédures qui ne tiennent pas compte des principes ou traditions juridiques propres à chaque pays, notamment ceux relatifs à la loi de 1881 sur la liberté de la presse.
- L’uniformisation pourrait introduire un contrôle préalable ou indirect sur les décisions judiciaires, réduisant ainsi l’indépendance du pouvoir judiciaire national face aux instances européennes.
- En cas de conflit entre les procédures européennes et la législation interne, l’arbitrage opéré au niveau européen risquerait de primer, ce qui limiterait la portée des recours nationaux.
- Il est également crucial de souligner que le règlement rend possible, pour les autorités compétentes, de solliciter des précisions quant à l’origine des sources d’information utilisées par les médias. Cette faculté, même encadrée par le texte européen, introduit une nouvelle forme d’ingérence potentielle dans le travail journalistique. Elle pose la question de la protection des sources, qui demeure un principe fondamental consacré par la loi de 1881 et la jurisprudence nationale. Or, en permettant aux autorités de requérir directement aux médias des informations relatives à leurs sources, le règlement ouvre la voie à des risques accrus pour la confidentialité, et donc à une possible dissuasion des journalistes d’investigation, des lanceurs d’alerte, ou des informateurs anonymes.
5) Le statut de « médias indépendants » instauré pour les plateformes numériques, offre à certains médias une reconnaissance spécifique. Notamment en cas de retrait ou de restriction de leurs contenus, les plateformes devront faire une notification au média concerné et justifier leur décision (Médiapart et le Monde ont déjà obtenu ce statut). La Commission ne délivre pas ce statut de « médias indépendants »
L’obtention de ce statut dépend principalement du respect des critères définis par le règlement, (transparence, indépendance éditoriale et pluralisme) notamment :
- Les médias doivent publier des informations sur leurs propriétaires et leurs actionnaires afin de limiter les conflits d’intérêts.
- Les très grandes plateformes numériques doivent leur notifier et justifier toute suppression de contenus et permettre un recours.
- Les utilisateurs doivent pouvoir personnaliser leur accès aux contenus médiatiques sans que les plateformes imposent des biais algorithmiques
La Commission ne délivre pas de statut de « médias indépendants » mais dans la mesure où elle supervise l’application du règlement via le Comité européen pour les services de médias, elle veillera à son application indirectement.
Point de tension avec la loi de 1881
- Ce statut qui n’existe pas en droit français. S’il peut introduire ponctuellement une modernisation de la loi de 1881, il peut aussi ouvrir la porte à un risque de dépendance à des critères uniquement européens.
6) Le règlement prévoit la création d’un Comité européen des services de médias, composé des régulateurs nationaux, qui remplace l’ERGA. Ce comité, doté d’une indépendance institutionnelle, joue un rôle consultatif auprès de la Commission européenne et veille à l’application du règlement. Il dispose du pouvoir de formuler des avis contraignants.
La régulation française repose sur le juge judiciaire ou une institution spécifique comme L’ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) et non sur une autorité supranationale.
Il n’est fait aucune mention dans le texte européen d’un régulateur national spécifique pour la la presse et des agences de presse. Le pilotage de la mise en œuvre relèvera du Comité européen de régulation et des autorités nationales compétente. En France, l’autorité désignée est l’ARCOM qui en sera le superviseur.
Autre disposition incluse dans le MFA
a) Le MFA impose la publication claire de l’identité des propriétaires et des principales sources de financement des médias. Cette transparence vise à éviter les situations de concentrations opaques ou d’influence cachée.
- Il convient de souligner que cette disposition, absente du cadre législatif français actuel, représente une véritable avancée en matière de modernisation de la loi nationale. En renforçant l’exigence de transparence et en offrant de nouveaux garde-fous contre les risques de concentration et d’influences cachées, elle marque une évolution positive qui vient consolider la confiance dans le secteur médiatique et audiovisuel.
II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LE SECTEUR AUDIOVISUEL.
Le MFA apporte également des évolutions substantielles au secteur audiovisuel, touchant les diffuseurs, les plateformes, et les fournisseurs de contenus.
1) Indépendance des rédactions :
Les rédactions de l’information dans les chaînes de télévision ou de radio doivent être à l’abri des pressions politiques ou économiques. Les Etats membres doivent garantir des procédures de nomination et de révocation des responsables éditoriaux fondées sur des critères transparents et objectifs.
En France, France Télévision et Radio France notamment ont déjà revu leurs procédures de nomination des dirigeants et mis en place des Comités indépendants pour les sélections de candidats.
Un Directeur de l’information d’une chaîne publique ne pourra plus être nommé ou révoqué sans justification et il y a un appel possible devant un organisme indépendant européen.
2) Pluralisme des contenus et diversité culturelle.
Le MFA impose des quotas minimaux de contenus européens et des engagements en faveur de la diversité culturelle sur l’ensemble des plateformes audiovisuelles, y compris les nouveaux acteurs numériques. Une plateforme de streaming devra garantir qu’au moins 30% de son catalogue est composé d’œuvres européennes et devra rendre des comptes à l’autorité européenne compétente.
Point de tension avec la loi de 1986
- Cette exigence implique l’instauration de quotas de diffusion ainsi que des obligations relatives à la production locale. Cela pourrait limiter la faculté de chaque État membre à adapter les contenus culturels selon ses spécificités, réduisant ainsi leur marge de manœuvre sur le plan culturel.
3) Le Media Freedom Act introduit des dispositions qui risquent de supplanter celles prévues par la directive sur les services de médias audiovisuels (SMA), notamment en ce qui concerne la diversité culturelle. Cette superposition crée un risque de confusion réglementaire et pourrait remettre en question l’équilibre établi entre les différents textes européens, fragilisant la capacité des Etats membres à préserver leurs orientations nationales. Surtout le règlement traduit la complexité des enjeux liés à la diversité des modèles audiovisuels et culturels.
Point de tension avec la loi de 1986
- La directive SMA a été transposée dans la législation française afin de préserver les principes déjà acquis par le cadre juridique national. Son application se caractérise par une plus grande souplesse, permettant une adaptation aux spécificités du contexte français.
Autres dispositions incluses dans l’EMFA
a) Malgré les obligations de transparence, les plateformes conservent un pouvoir de modération qui peut invisibiliser les chaînes traditionnelles.
b) Il est imposé des mesures contre la concentration et une surveillance accrue des fusions et acquisitions dans ce secteur.
En France, une régulation à plusieurs visages :
c) L’ARCOM qui a été désignée comme régulateur principal, jouera un rôle central dans la supervision des systèmes IA à fort impact sur les processus démocratiques et médiatiques.
La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) interviendra en complément notamment pour garantir le respect des droits fondamentaux dans les usages de l’IA liés à la vie privée aux données personnelles.
LA DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) et la DGE (Direction générale des entreprises) assureront la coordination globale du dispositif en lien avec les enjeux économiques et de conformité des acteurs industriels
Les systèmes d’IA utilisés dans l’administration de la justice, l’éducation, l’emploi et l’accès aux services essentiels seront placés sous la vigilance de plusieurs institutions : CONSEIL D’ETAT, COUR DE CASSATION ET COUR DES COMPTES pour les usages judiciaires
LE HFDS (Haut fonctionnaire de défense et de sécurité) pour les infrastructures critiques, en raison des risques systématiques liés à la cybersécurité et à la souveraineté numérique
Le projet de loi d’adaptation au droit européen issu des Etats généraux de l’information, a été transmis au Conseil d’Etat fin juillet. Il vise à préciser les rôles de chaque autorité et à formaliser la mise en œuvre du règlement IA ACT à l’échelle nationale dès la rentrée.
Le Ministère de la Culture aurait souhaité inscrire ce texte en deuxième lecture à l’Assemblée nationale début octobre
III – CONCLUSION
Il convient de rappeler que, dès la diffusion de la proposition de ce règlement par la Commission européenne, l’Institut iDFrights avait signalé auprès des autorités françaises et européennes, l’inadéquation profonde qu’il voyait à vouloir imposer un corpus commun à la presse et à l’audiovisuel, deux univers dont les législations et les enjeux diffèrent. La tentation d’affiner ou de corriger la substance du règlement au niveau national apparaît d’autant plus vaine qu’il s’agit d’un instrument européen d’application directe, dont les marges d’adaptation nationale sont limitées et soumises au contrôle rigoureux de la Commission européenne.
Pour que les droits relatifs à la liberté d’expression soient effectivement protégés, il peut être dangereux d’imposer un modèle unique à des secteurs dont les dynamiques, les contraintes et les missions diffèrent profondément.
Seule une approche respectueuse des particularismes, attentive aux besoins des acteurs, aurait permis d’éviter la fragmentation et la perte de confiance des professionnels et du public.
Comme le soulignait notre Institut, dans un article précédent sur la portée du Media Freedom Act : « ce n’est pas uniquement une question juridique, mais aussi une question de subsidiarité et de proportionnalité. Si l’on veut que nos droits et la liberté d’expression de l’ensemble de ces deux secteurs soient protégés, nous devons absolument préserver nos deux écosystèmes ».

Jean-Marie Cavada
Président iDFrights

Colette Bouckaert
Secrétaire Générale iDFrights