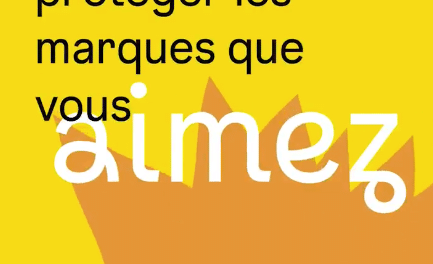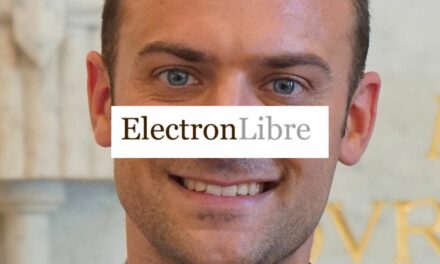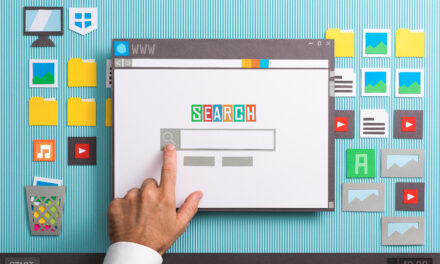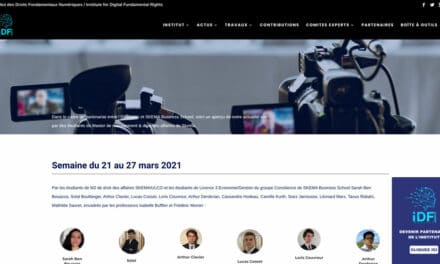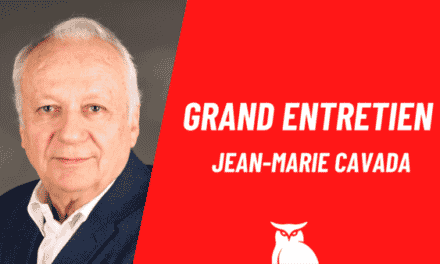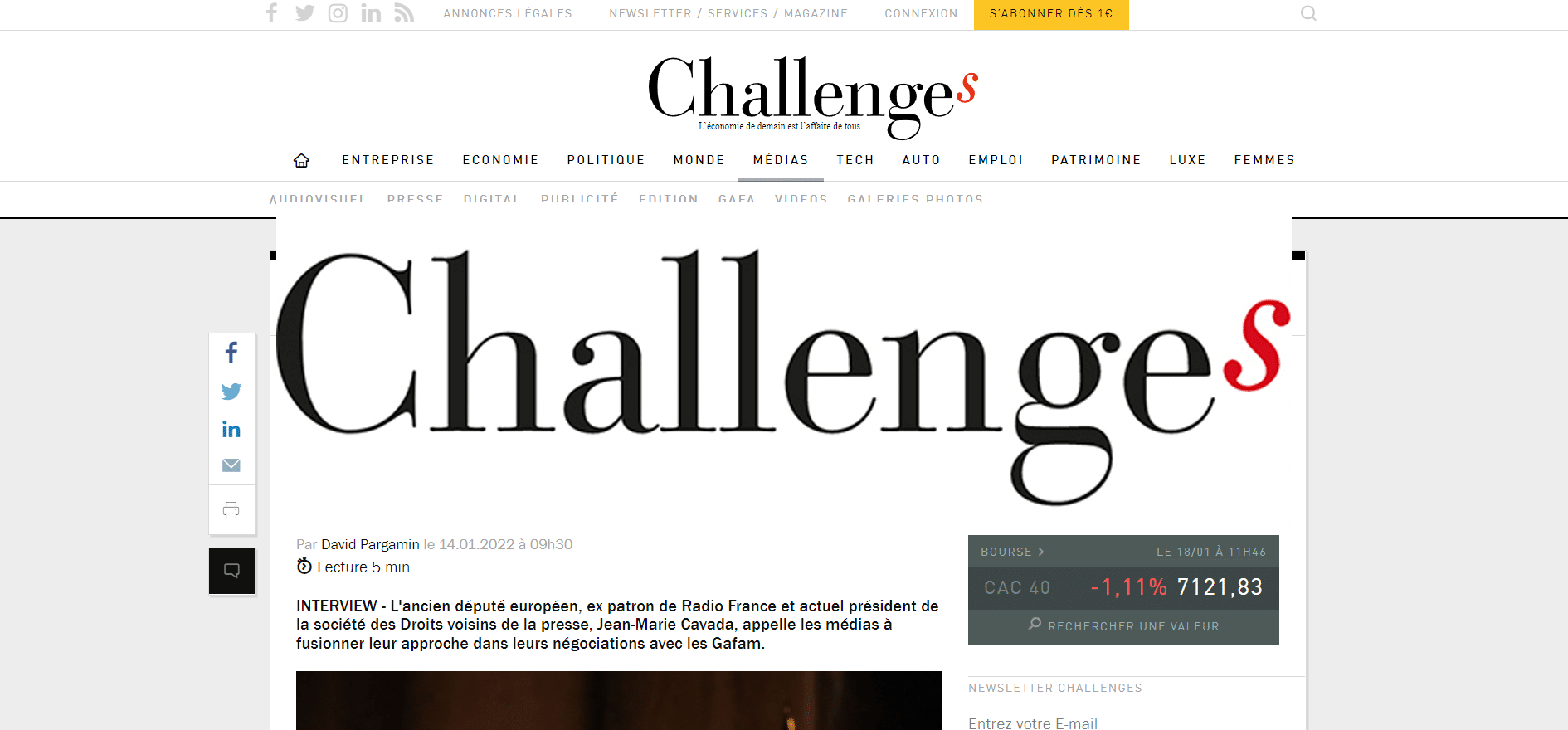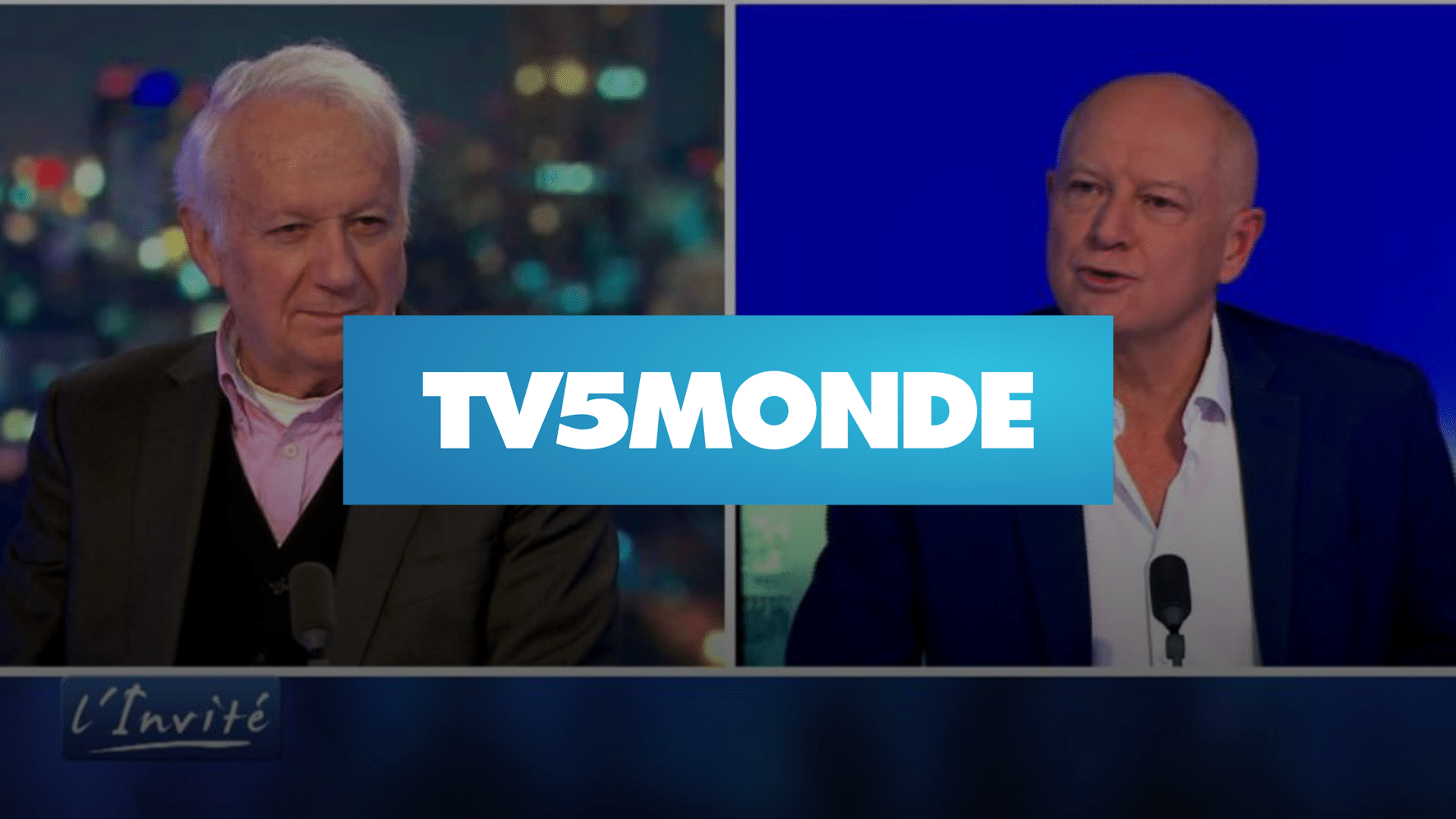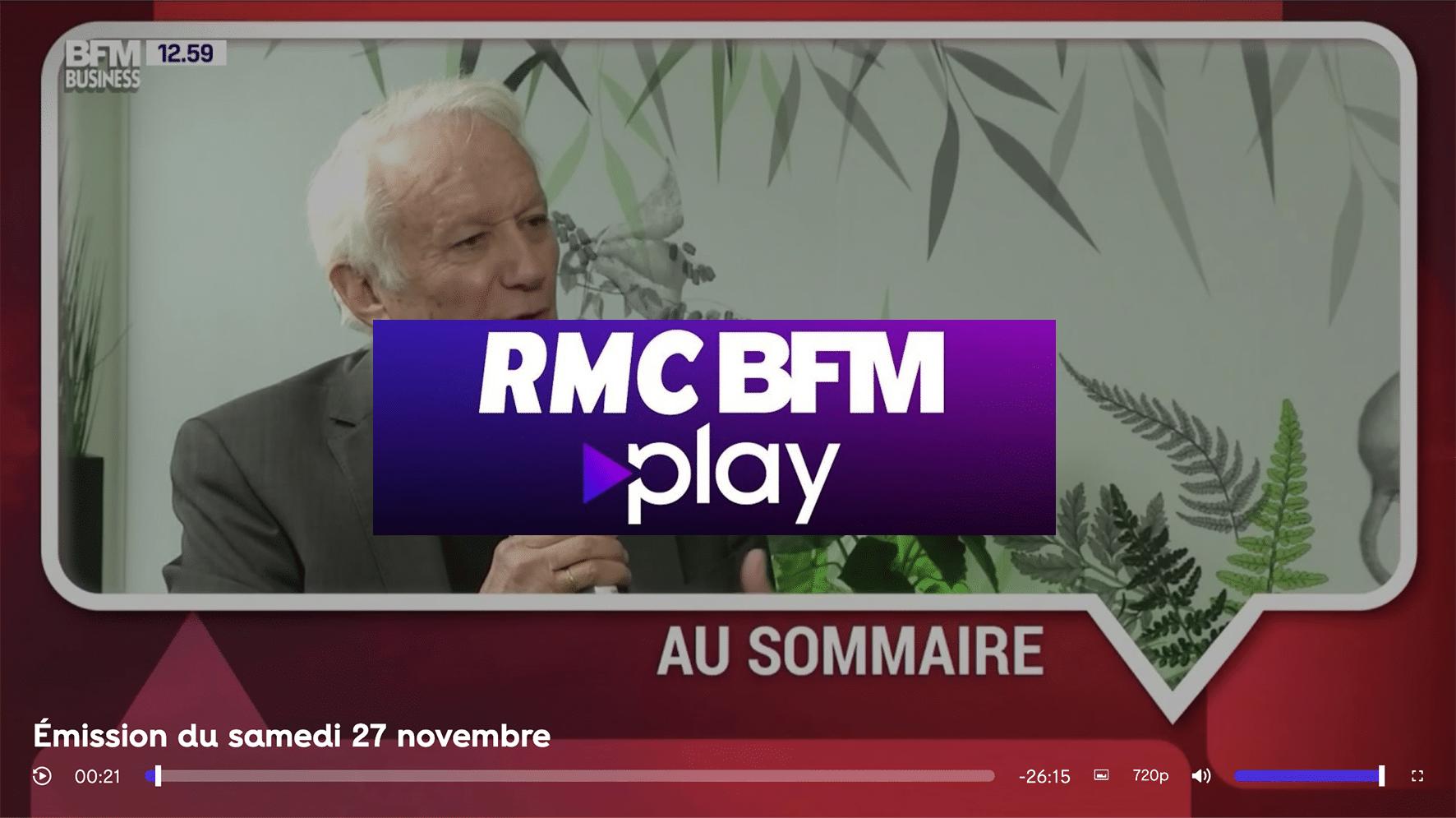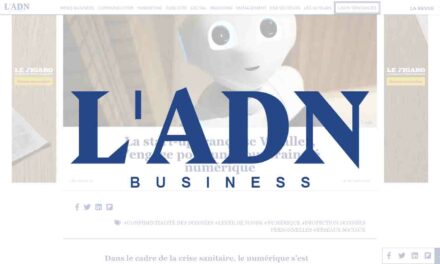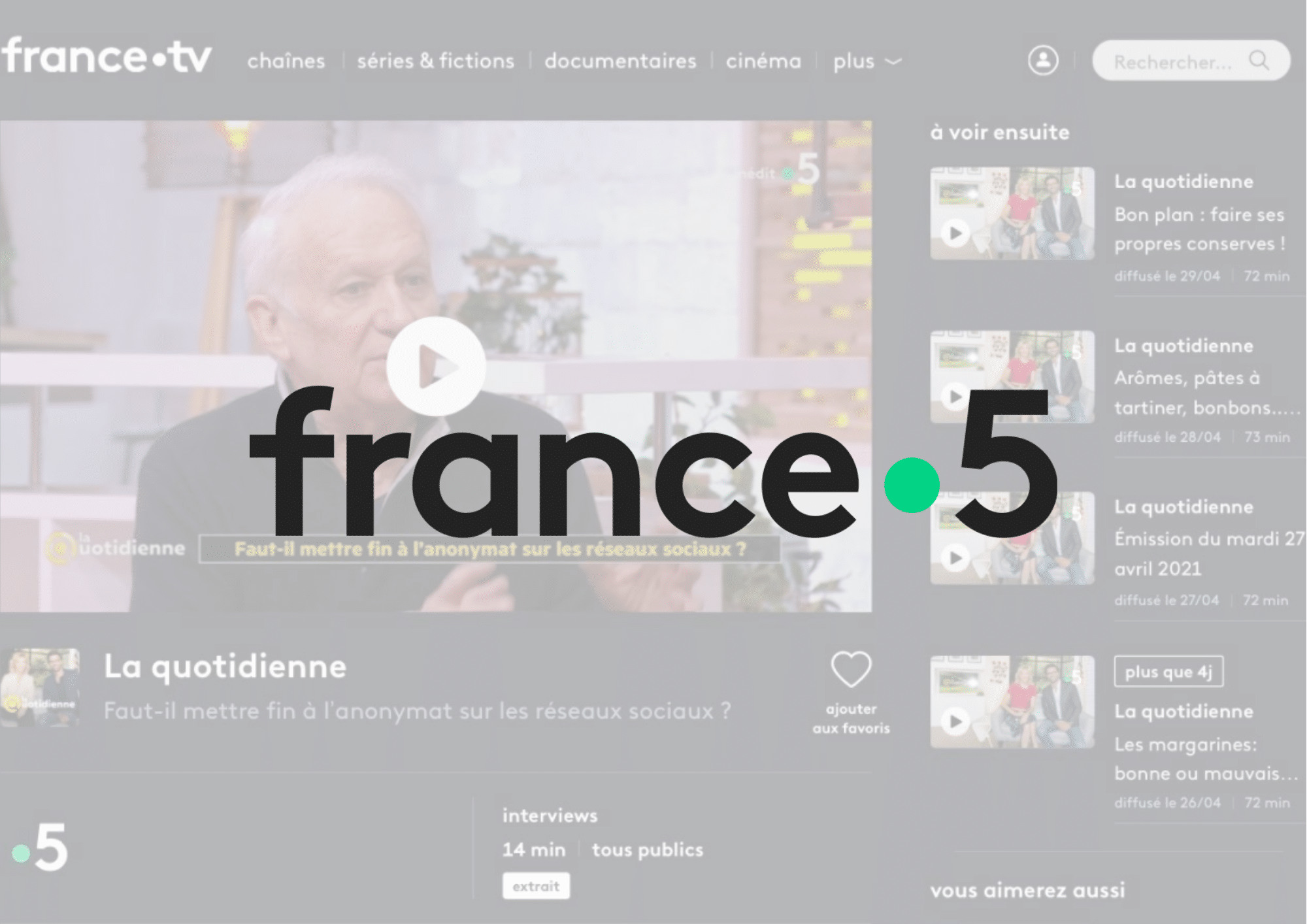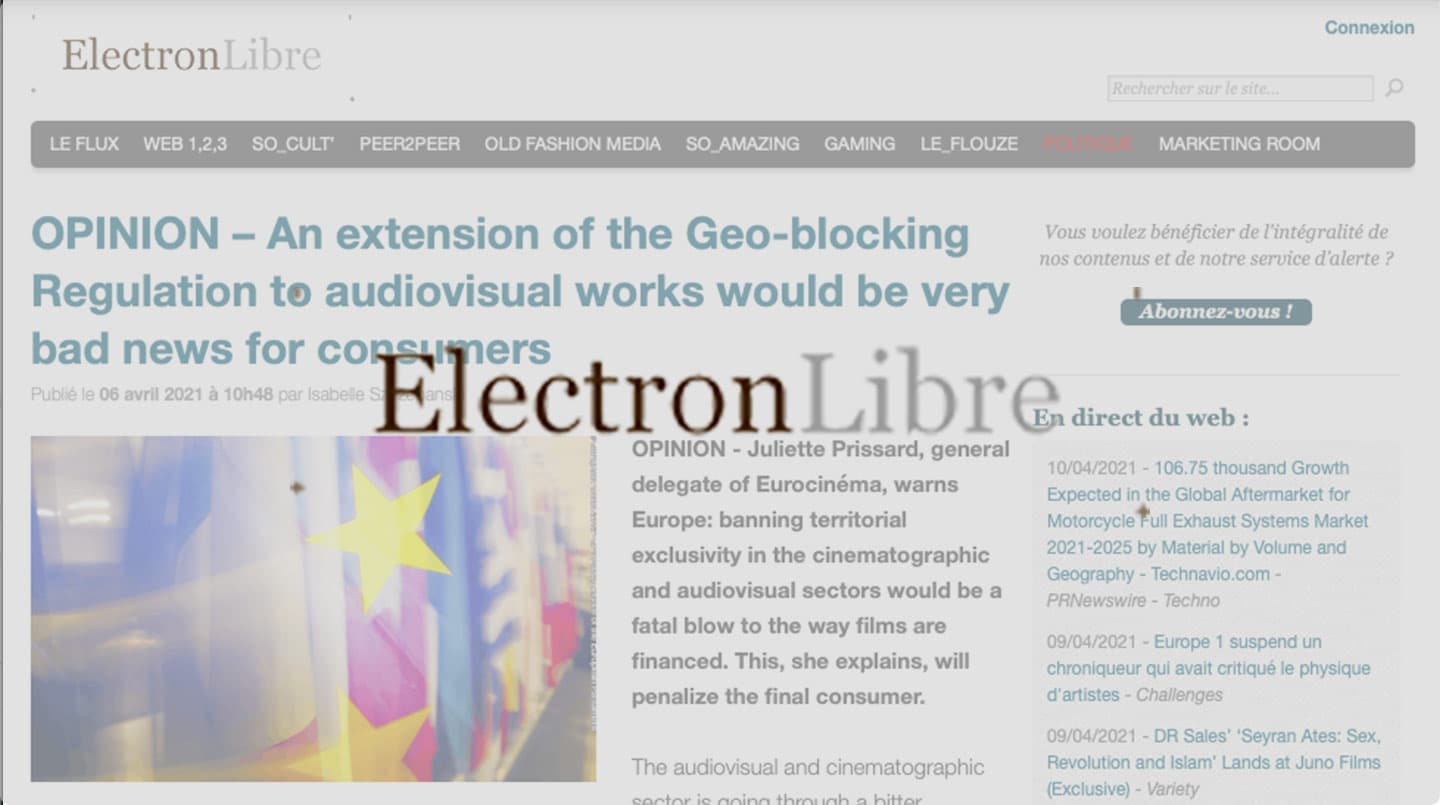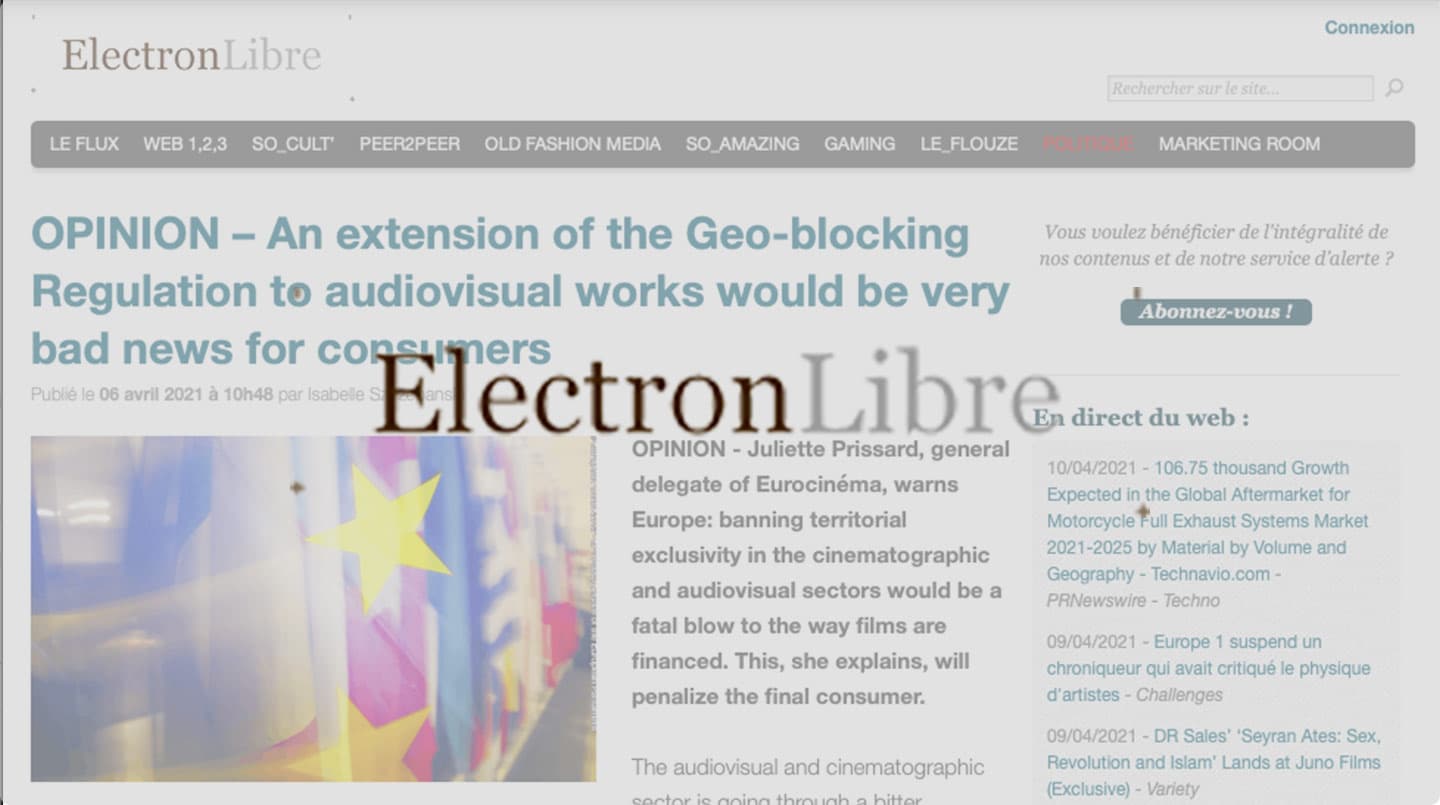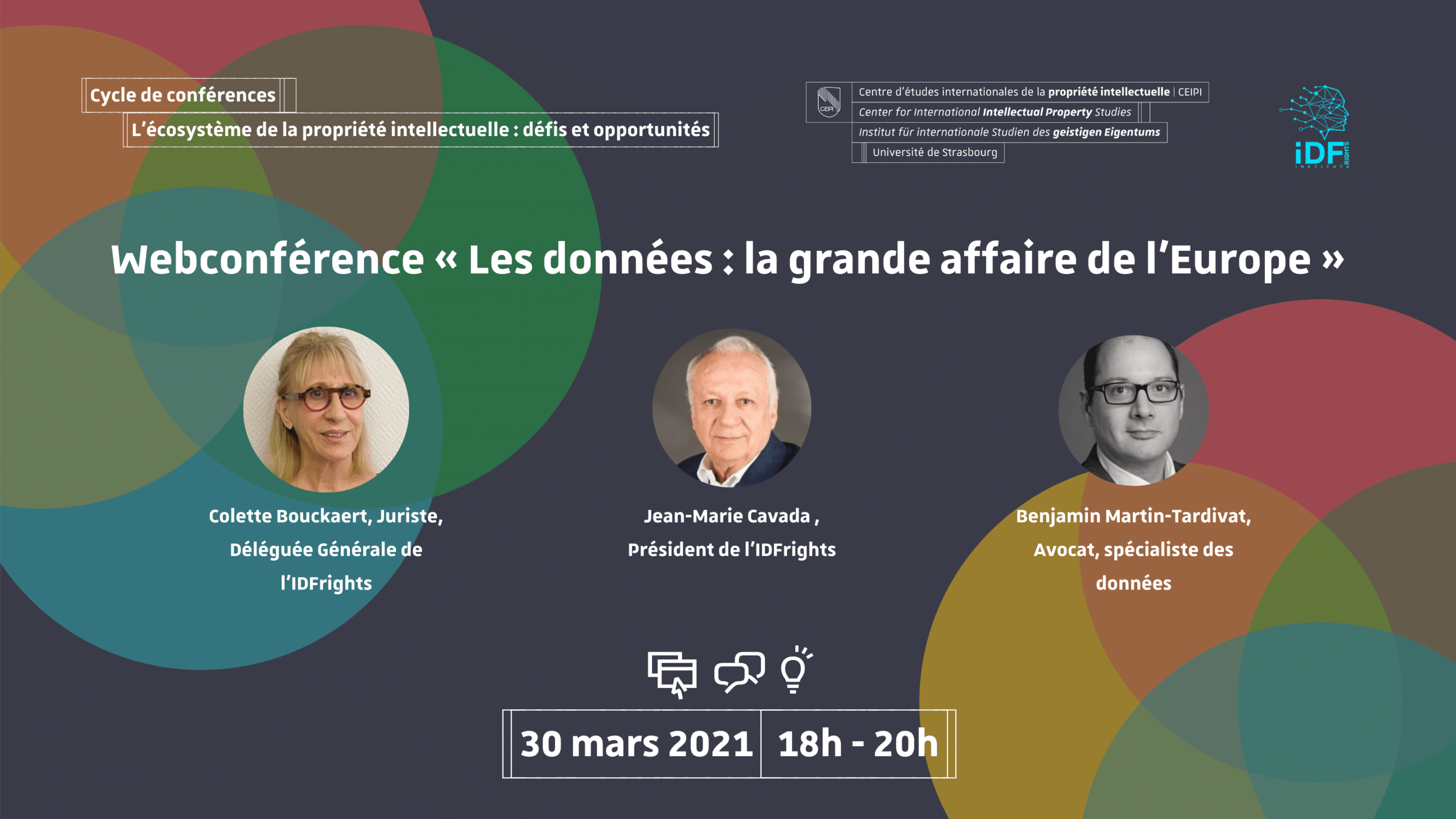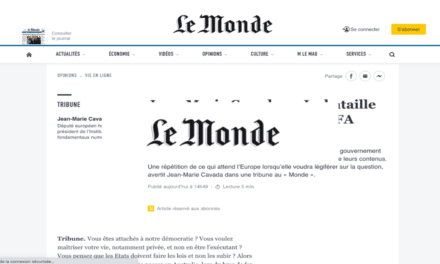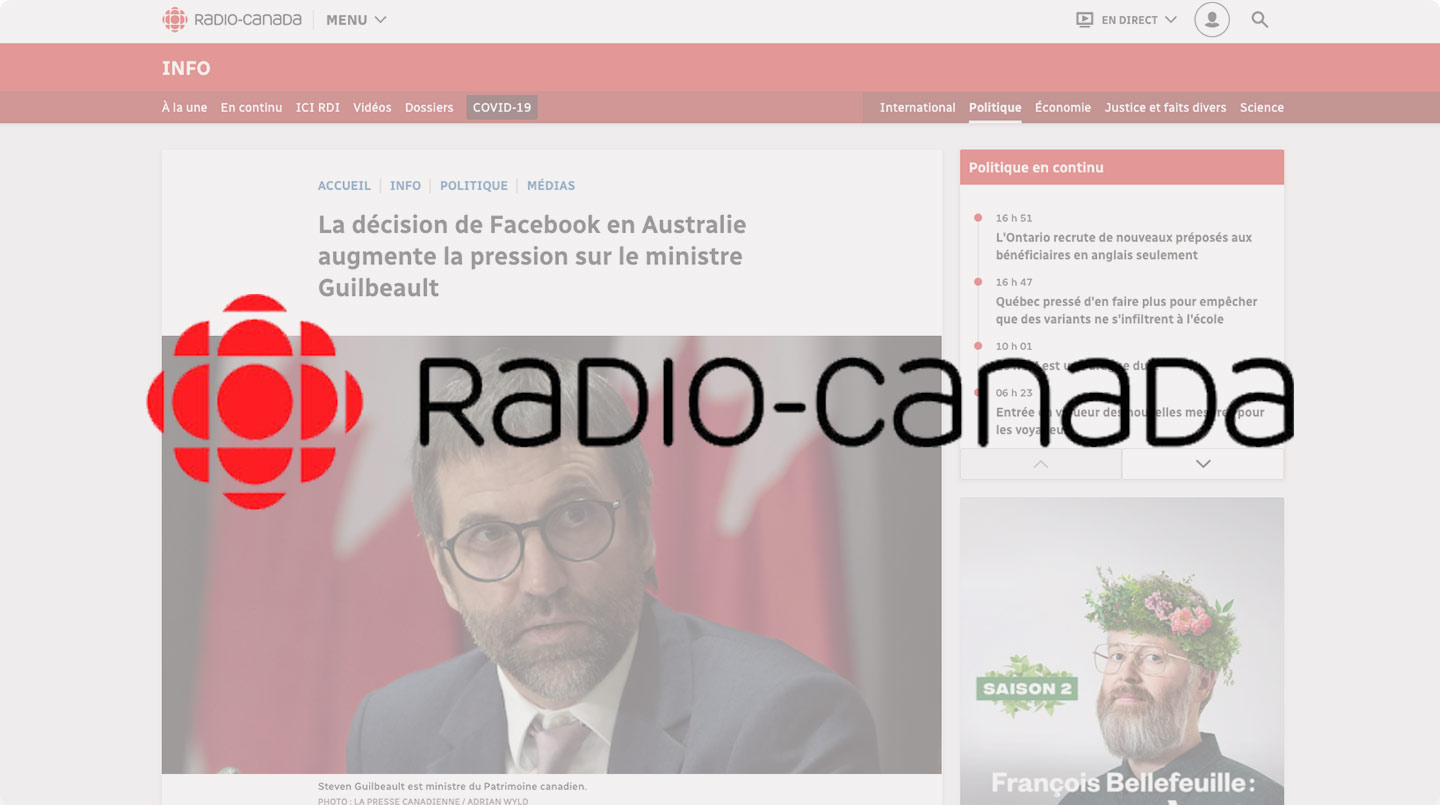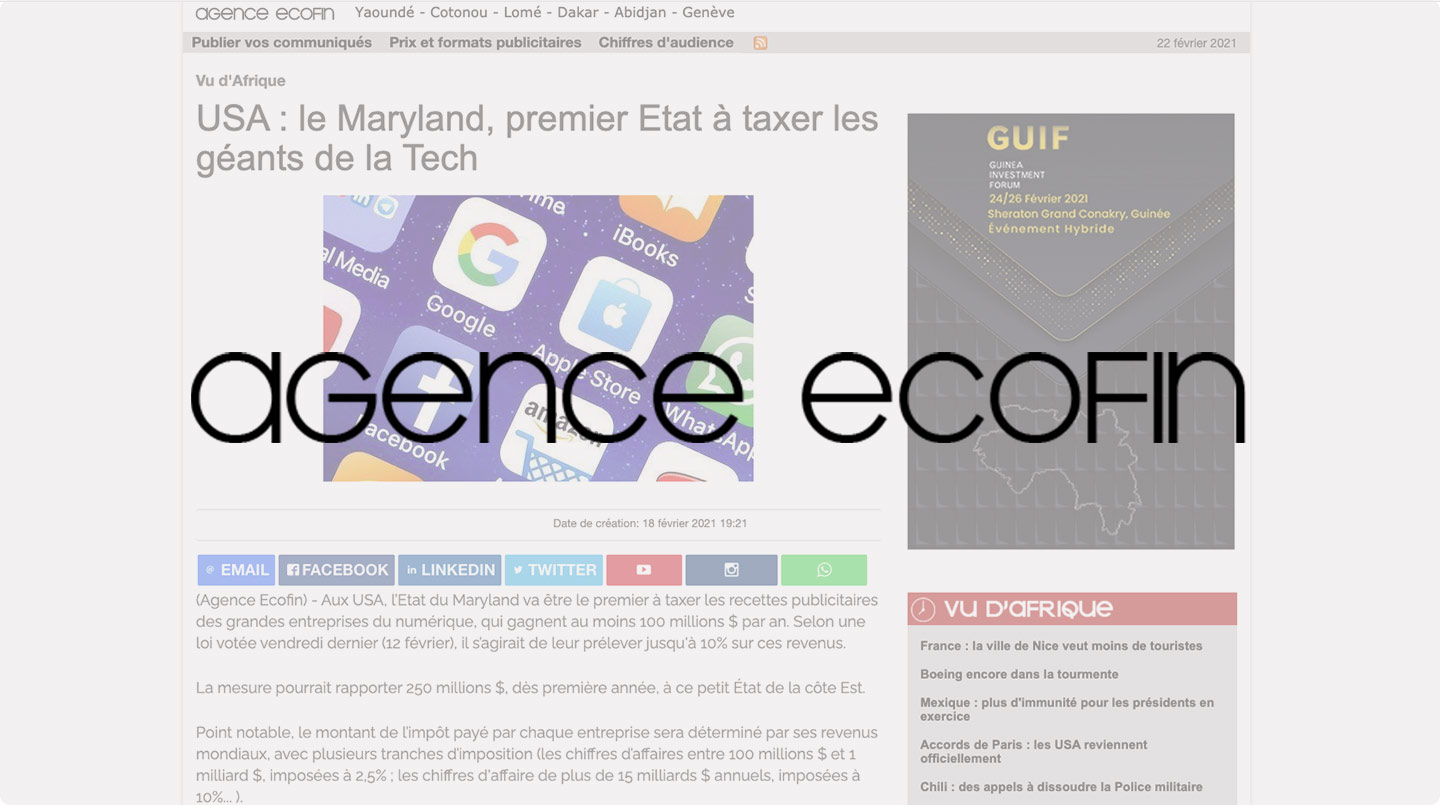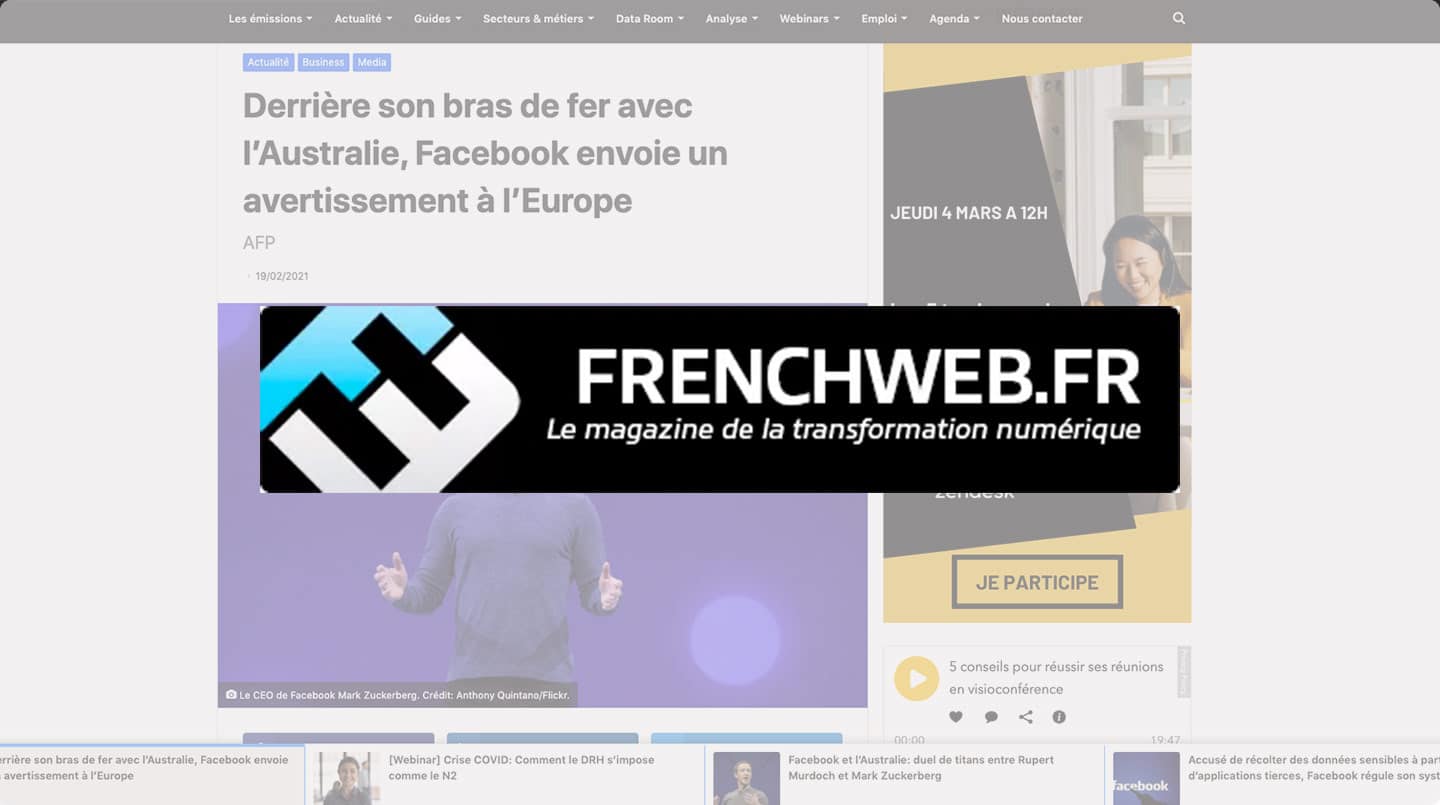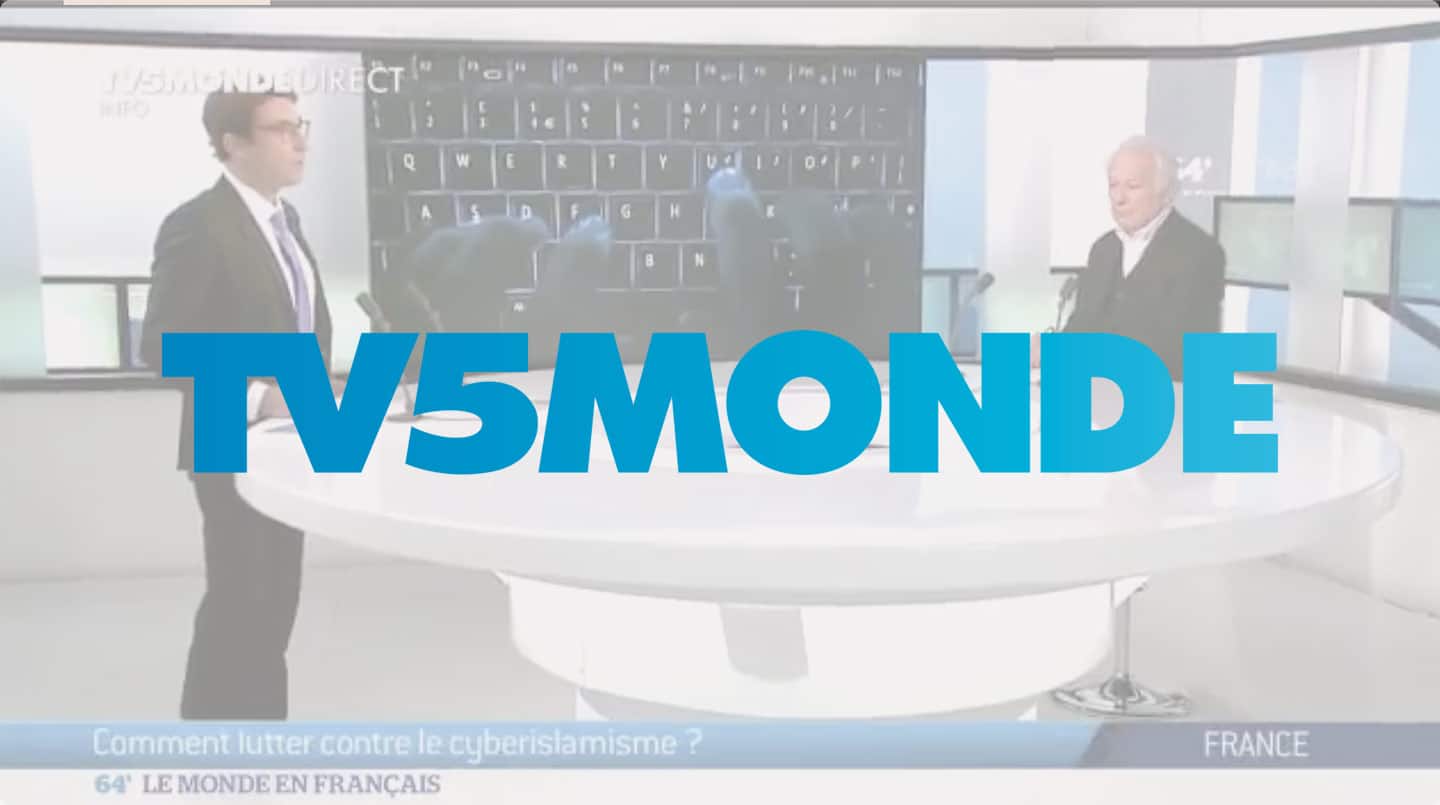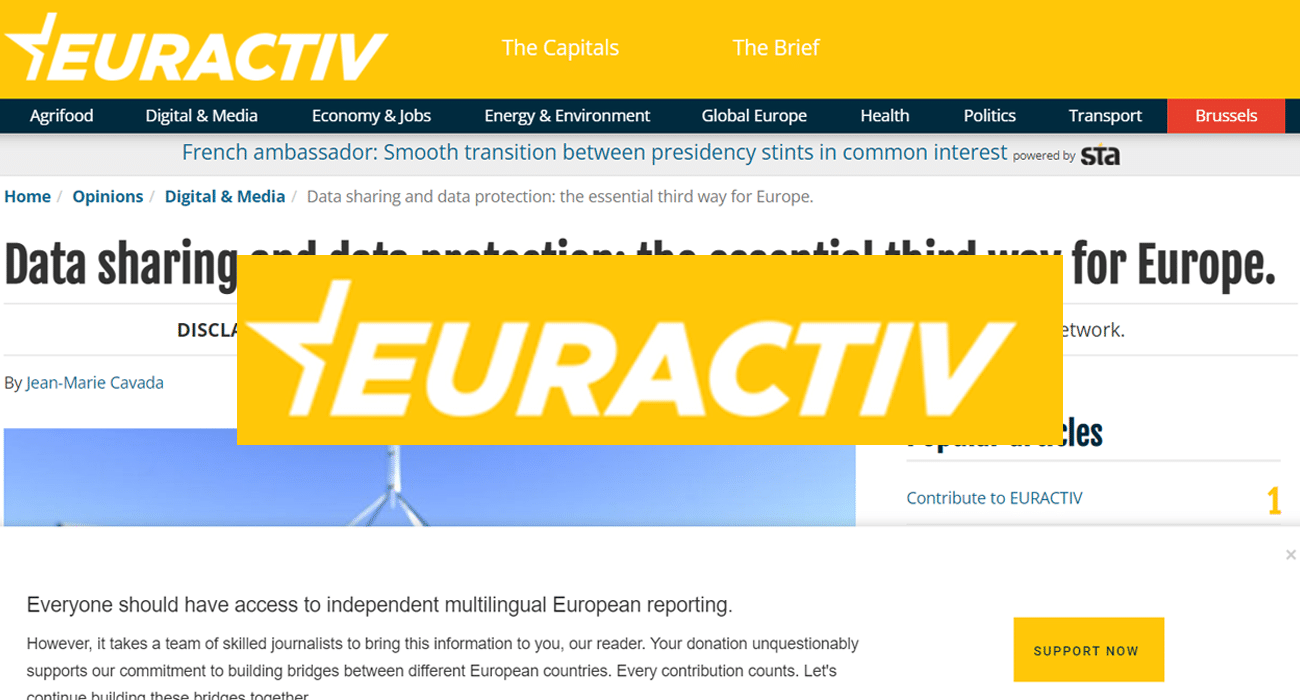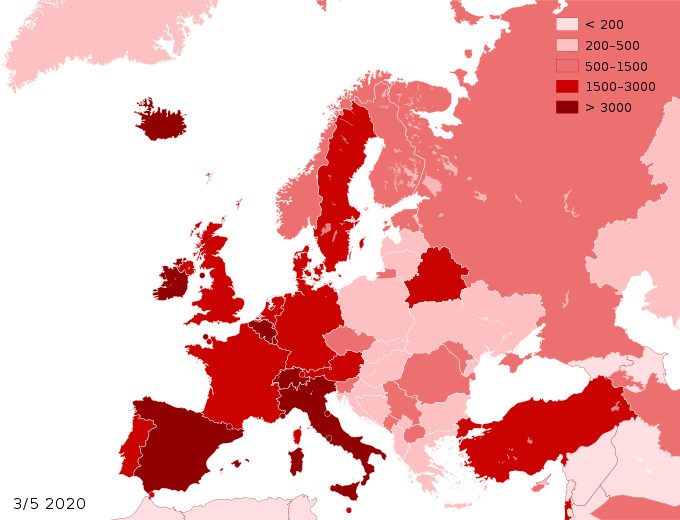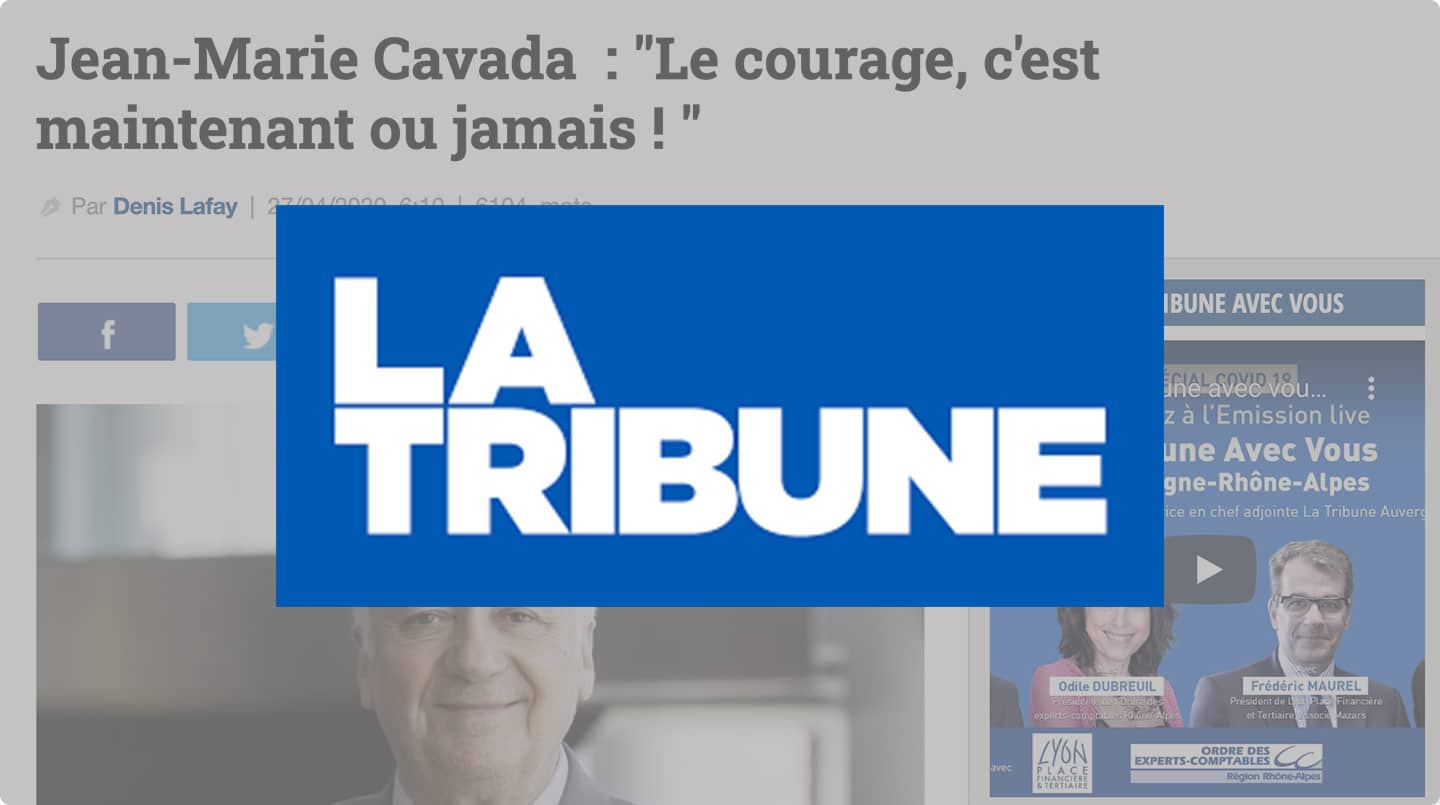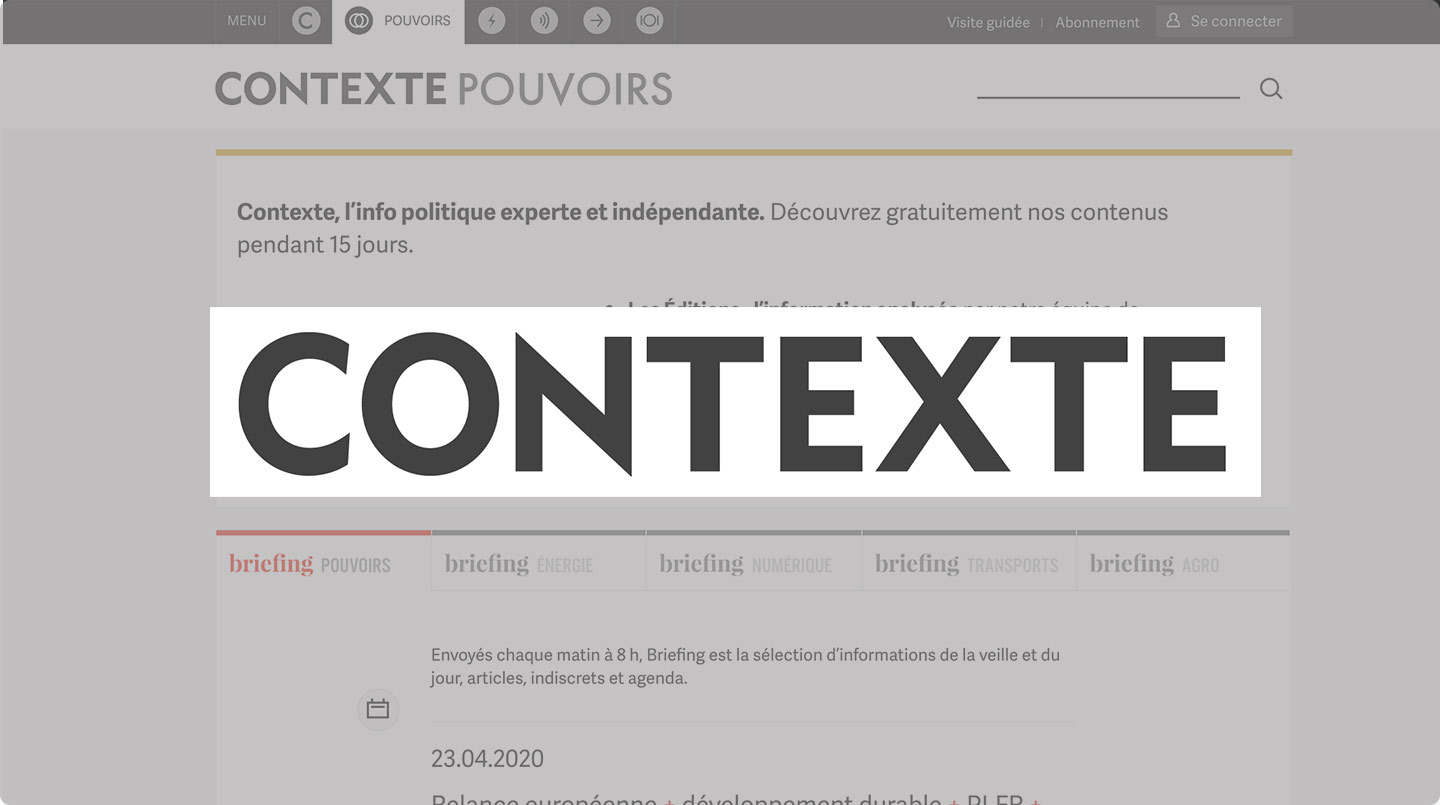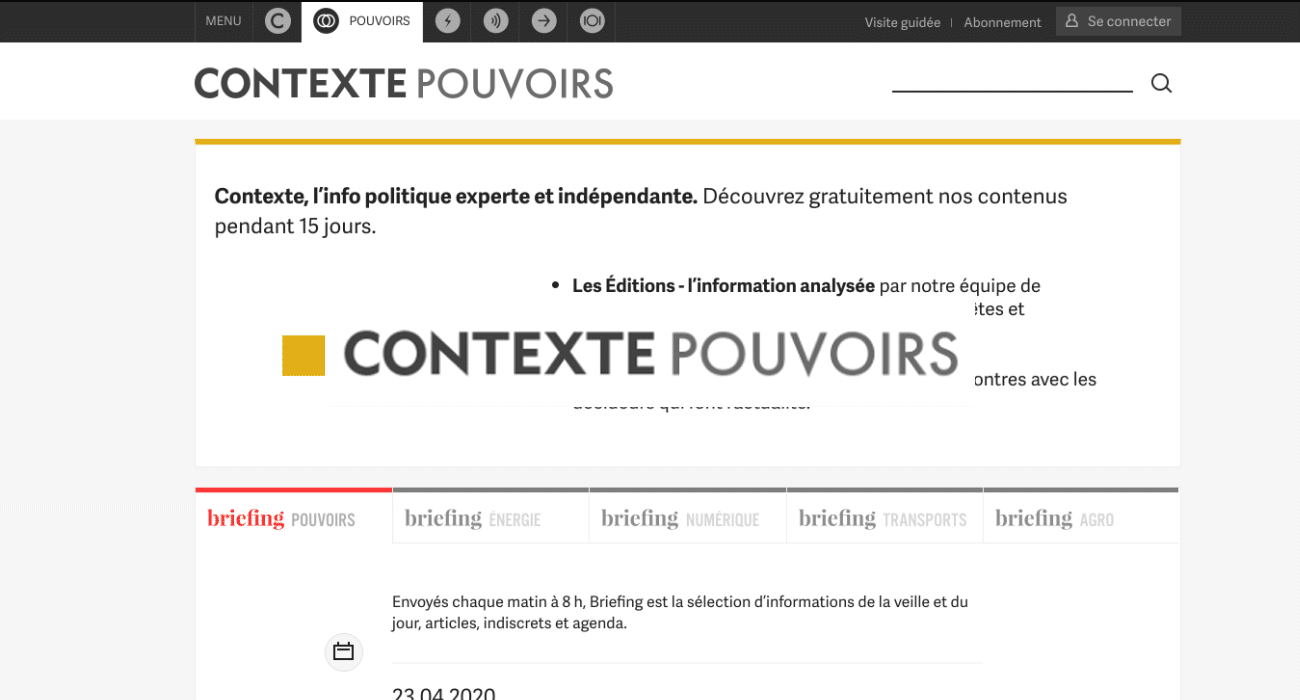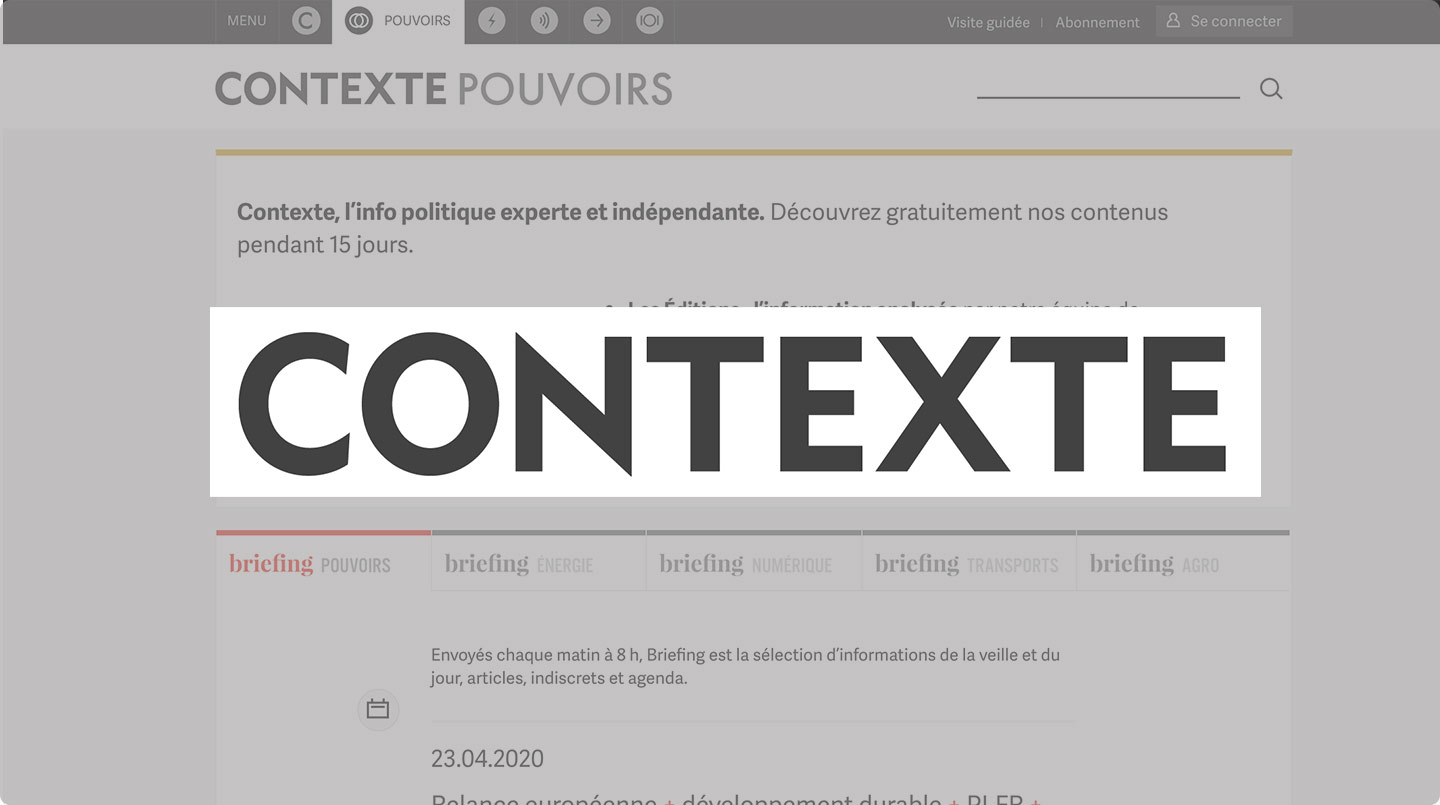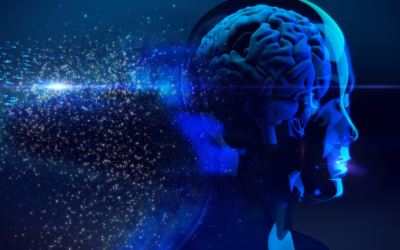Vae victis. Malheur aux vaincus. Le spectacle offert par la vie politique américaine au cours des derniers jours fait irrésistiblement penser à cet affront subi par les occupants d’un autre Capitole, le vrai celui-là, à ce même usage incontrôlé de la force alliée à la mauvaise foi. La chute de la maison Trump ne doit cependant pas détourner l’observateur des faits et leur réalité doit commander l’interprétation de ces derniers. Quitte alors à prendre conscience de la démission des démocraties contemporaines face à l’ingérence des plateformes numériques dans l’exercice de nos libertés fondamentales.
Au plan juridique, tout d’abord, peu d’incertitudes demeurent quant à la gravité des évènements en cause. L’assaut du Capitole est sans précédent historique et les conditions dans lesquelles celui-ci s’est réalisé devant les caméras du monde entier laissent les opinions publiques interloquées. Eloignés de tout souci de dissimulation, les acteurs de cet assaut revendiquaient en effet ouvertement un véritable titre à agir, un quasi-titre de propriété sur cet emblème de la démocratie, au prétexte de fraudes électorales dont les juridictions
américaines avaient unanimement écarté la vraisemblance et auquel ils prétendaient remédier par la force.
Ce faisant, l’obstacle ainsi dressé à la réalisation d’une procédure constitutionnelle, la certification des résultats de l’élection à la présidence des Etats Unis, révèle une dangereuse banalisation des querelles. La contestation politique est ponctuelle et contingente et elle ne saurait être confondue avec la contestation de l’ordre constitutionnel. Outre le fait qu’une partie du parti républicain a prêté une oreille obligeante à cette assimilation, force est d’être surpris devant la faiblesse des protections dont la Constitution bénéficie et que cet épisode baroque révèle.
Une fois écartée l’hypothèse peu vraisemblable d’une contrition conduisant Donald Trump à la démission, à l’image de Richard Nixon, vient immédiatement à l’esprit l’usage de la procédure d’impeachment. L’article II de la Constitution américaine qui la prévoit permet en effet de mettre en accusation le président des Etats Unis, phase réservée à la Chambre des représentants, avant de le juger, phase appartenant au Sénat et relevant de la majorité des deux tiers. La Chambre des représentants a voté à trois reprises une telle mise en accusation du Président, en 1868 pour Andrew Johnson et, plus récemment, à propos de Bill Clinton et de Donald Trump en lien avec une conversation avec des responsables ukrainiens. Tous furent acquittés par le Sénat. Lenteur, complexité et politisation des débats rendent en l’espèce impossible l’aboutissement de cette possibilité avant l’expiration légale du mandat présidentiel à la date du 20 janvier. Tout reste peut-être à imaginer quant à son usage à d’autres fins, comme certains démocrates semblent enclins à le faire.
Une autre possibilité a alors été évoquée, celle qui serait offerte par l’article IV du 25e amendement de la Constitution américaine. Réclamé à la suite de l’attaque cérébrale du président Wilson et en réaction à l’influence de son épouse, il permet de régler radicalement depuis 1967 l’hypothèse de l’incapacité du Président d’exercer ses pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge et de les confier au vice-président, fut-ce à titre temporaire en cas d’indisponibilité. Tout se joue donc ici sur l’évaluation de cette incapacité. Celle-ci laisse la part belle au cabinet du président dont la majorité des membres doit saisir le président de la Chambre et du Sénat, la durée de la procédure excédant la partie du mandat de Donald Trump restant à courir aujourd’hui. On comprend donc la facilité avec laquelle la presse comme une partie du camp démocrate s’en sont emparée, là encore sans grand souci d’efficacité et au seul prétexte d’accréditer l’image de son désordre mental.
L’impuissance du système constitutionnel américain à se prémunir de dérèglements tels que ceux auxquels le monde vient d’assister surprend donc.
Surprise à la mesure de l’invraisemblance des comportements du président en exercice. Faute de pouvoir mettre
en cause sa liberté constitutionnelle d’opinion et d’expression, au vu de la démission politique désastreuse du parti auquel il appartient et des contrepoids dont on croyait le système politique américain armé. Il ne restait alors à mettre en question l’instrument sur lequel sa conquête et son exercice du pouvoir se sont largement appuyés : celui des réseaux sociaux.
Il n’est pas utile de rappeler l’usage déraisonné que Donald Trump a fait de cet outil, en matière de politique étrangère ou intérieure, ni d’en tenir une comptabilité statistique. Véhiculant une présentation travestie de la réalité et un solide mépris de celle-ci, le gimmick « fake news » tenant lieu d’argumentaire, cette pratique de
communication a également ouvert la voie à des messages de haine et de discrimination d’une ampleur jamais entrevue jusqu’alors. Le sourire suscité par l’approximation et la grandiloquence de certains messages s’est rapidement effacé devant les encouragements à peine dissimulés à la violence, lors de l’épisode Blacks Lives Matters par exemple, ou le soutien aux discours identitaires et suprémacistes.
L’inertie revendiquée des réseaux sociaux face à ces excès durant le mandat de Donald Trump choque alors autant qu’elle inquiète. Au nom de la liberté d’expression, ce refus d’une régulation quelconque a suscité critiques et interrogations.
En premier lieu parce que la parole présidentielle, lorsque son titulaire s’exprimait sur son site officiel, ne saurait être réduite à celle de n’importe qui, comme cela pourrait être le cas de son compte personnel. On imagine difficilement à quel titre en effet le contrôle de la parole du représentant de la première puissance du monde pourrait être effectué. Ambiguïté dont se sont évidemment emparés les acteurs privés de la communication numérique, de Twitter à Facebook, brandissant la liberté d’expression de tous pour éviter d’assumer leur responsabilité.
En second lieu car ces mêmes acteurs, au prix d’un retournement de position sans vergogne, se sont arrogés depuis le pouvoir d’un tel contrôle, suspendant ainsi de facto l’activité numérique de l’actuel occupant de la maison Blanche. Suspecte, cette vertu retrouvée interroge.
Le 8 janvier, Twitter a ainsi condamné à la frustration les 88 millions de ses followers, au prix de justifications pesant leur poids d’hypocrisie, dans un message sobrement intitulé « Permanent suspension of @realDonaldTrump ». Parce que Donald Trump avait déclaré de ne pas vouloir se rendre à la cérémonie d’investiture de
son successeur, il ferait de celle-ci une cible de manifestations potentiellement violentes, justifiant ainsi que ses messages ne soient plus relayés… Suivi en cela par Facebook, Snapchat ou Twitch, la plateforme numérique s’est ainsi érigée avec ses homologues en gardienne de l’ordre public, comme en a témoigné un peu plus tard le bannissement de sites conspirationistes et autres. Cette attitude pose alors ouvertement la question de la légitimité d’une telle intervention, abritée derrière le flou juridique qui protège ces puissances numériques et les soustrait des obligations pesant sur la presse ordinaire.
Hors l’intervention d’un juge ou d’un régulateur indépendant, comment accepter qu’il en aille ainsi, que s’instaure une police des esprits et des bien-pensants exercée par des acteurs commerciaux dont l’absence de principes et de morale a précisément nourri et amplifié le désordre ambiant ? Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos dans le rôle des oies du Capitole ? Une erreur de casting, sans aucun doute.
HENRI LABAYLE
Son champ d’expertise scientifique porte notamment sur le respect des droits fondamentaux et les développements de l’Espace de liberté sécurité et justice de l’Union dont il est un observateur reconnu depuis ses origines.



















































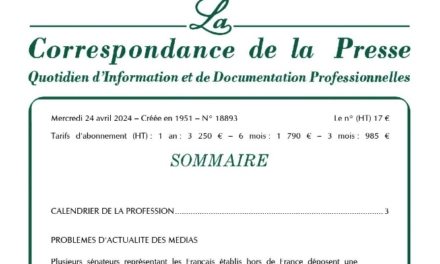

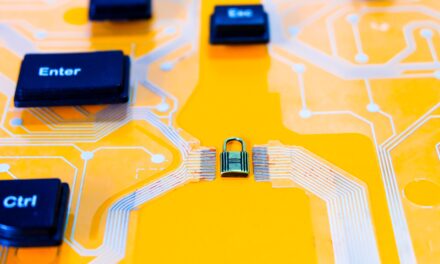



![[DSA, AI Act] Régulation, et si l’Europe avait raison ? Podcast les Eclaireurs du Numérique avec Jean-Marie Cavada](https://idfrights.org/wp-content/uploads/2023/12/8c234391-01e8-40d4-9608-4ea6c80d4f11-440x264.jpg)